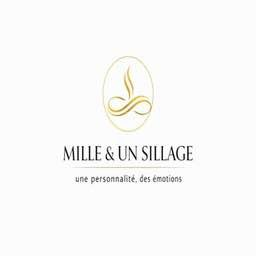Décentralisation, domanialité nationale et gestion des conflits fonciers à l’aune du pluralisme juridique au Sénégal
Abdoul Aziz Sow
Docteur d’Etat en Droit Public
Expert Foncier
Introduction
La décentralisation constitue un paradoxe en matière de gestion des conflits fonciers : parce qu’en elle-même, elle porte les germes des conflits qu’elle prétend pourtant gérer. Au lieu de les minimiser, elle tend au contraire à les multiplier. Telle n’a pourtant pas été la volonté initiale du législateur sénégalais lorsqu’il votait les lois 96-06 et 96-07 du 22 mars 1996 portant Code des Collectivités locales. D’ailleurs, la loi 64-46 du 17 juin 1964 sur le Domaine Nationale a pourtant été initiée pour régler définitivement les malentendus, sources de conflits en matière de gestion du foncier. Dans l’esprit de ses initiateurs, comme dans celui de ceux qui l’ont soutenu, la décentralisation est un idéal pour une bonne gouvernance, autrement dit, une meilleure chance accordée aux collectivités locales afin qu’elles deviennent des actrices et des gestionnaires du développement à la base, et non de simples gérants des politiques toujours centralisées. En effet, l’attitude du gestionnaire du développement doit lui permettre de faire face aux mutations qui s’opèrent à tous les niveaux. Ces mutations s’accordent avec des revendications de plus en plus pressantes et pertinentes des couches populaires, véritables acteurs du monde rural, qui naguère étaient étouffées tant sur le plan politique qu’économique (les paysans, les éleveurs, les associations de développement etc.). La gestion du foncier, dont l’affectation revient désormais aux communautés rurales est hautement conflictuelle : parce que les enjeux sont nombreux et difficiles à maîtriser.
Les différents blocages présentés dans les récents rapports sur l’évolution de la décentralisation laissent entrevoir une augmentation de ces tensions, parce que les potentialités de conflit, quand on aborde la question sous l’angle du droit et de l’anthropologie, sont telles qu’on peut se laisser aller au pessimisme. Les conflits existants sont connus, mais ceux résultant de la gestion du foncier semblent être les plus importants et les plus dangereux et justifient notre problématique.
Cependant, on ne peut parler du système juridique Sénégalais en ignorant deux grandes étapes intimement liées : il s’agit de la loi sur le domaine national et des textes sur le droit de la décentralisation. Ces deux axes constituent des étapes charnières au droit Sénégalais, dans la mesure où elles vont lui imprimer. Il faut rappeler que les puissances coloniales avaient mis en place dans les territoires conquis un ensemble de mécanismes visant à asseoir leur politique dans les domaines économiques, sociaux, culturels et politiques. Ainsi, en matière foncière, elles avaient édicté une réglementation qui reposait sur le code civil. Ce dernier favorisant la mise en place d’un système des inscriptions, leur permettait de s’approprier les terres dites vacantes et sans maître. Par la suite elles avaient édicté des lois et règlements successifs susceptibles de garantir leur mainmise sur les ressources naturelles en général et la terre plus particulièrement. Cette conception foncière a connu un âge d’or tout au long de l’époque coloniale avant de faire l’objet d’une remise en cause suite à l’accession des États africains à la souveraineté internationale qui leur offrait désormais l’aptitude de prendre en charge leurs propres affaires et de présider la destinée de leurs peuples. Ces acquis post-coloniaux ont été consolidés par certains principes proclamés par les instances internationales et qui devraient désormais régir les rapports entre les Etats. Parmi ces principes, on avait celui relatif « à la non- immixtion ou la non ingérence dans les affaires intérieures des États » , aboutissement logique de l’autre principe du « droit des peuples à disposer d’eux-mêmes ».
Ce contexte nouveau permettra rapidement aux jeunes Etats africains de se pencher avec minutie sur le legs colonial en vue de l’adapter à leur contexte. C’est dans ce sillage que s’inscrit l’action de ces États qui consistait à mettre en place un dispositif juridique ayant pour finalité une réadaptation du système foncier colonial à leurs propres réalités. Les différentes réformes foncières et agraires initiées à cet effet par les nouveaux dirigeants africains en sont une parfaite illustration. En effet, pour les États et les Administrations, la terre est un bien, un bien économique à mettre en valeur pour produire plus et pour réaliser le développement. Cette rupture d’avec la politique foncière coloniale avait pour soubassement une conception spécifiquement africaine reposant sur « la voie africaine du socialisme » qui mettait en exergue l’aspect communautaire et non individuel des formes de propriété, notamment dans les campagnes. C’est la raison pour laquelle la plupart des États du Sahel ont affirmé leur monopole sur la propriété de la terre, se posant à la fois comme héritiers modernes des anciens lamanes (chefs de terres) et comme des capitaines qui doivent mener le bateau de « modernisation » à bon port, par des textes de lois. André Peytavin, Ministre des finances disait dans l’exposé des motifs de la loi sur le domaine national dès 1959, qu’il fallait « mettre fin à une organisation foncière archaïque, de forme féodale ou seigneuriale » .
C’est dans ce cadre que le Sénégal avait décidé d’entreprendre dès le lendemain de son indépendance en 1960 une politique de décentralisation qui devait déboucher irréversiblement à la mise en place de nouvelles structures par des réformes susceptibles de permettre effectivement aux citoyens habitant un même espace géographiquement déterminé d’être impliqués et de s’impliquer dans la gestion des affaires de leur localité. En effet, depuis l’indépendance l’importance des droits coutumiers est reconnue par les anthropologues mais elle a été longtemps considérée comme une catégorisation juridique à laquelle devait se substituer un droit positif de type moderne. Cette tendance a dominé toutes les législations foncières des pays francophones. Parmi les mesures prises par le Sénégal en la matière afin d’améliorer l’utilisation de l’espace cultivé, la loi sur le domaine national (1964), la constitution des communautés rurales (1972) ayant pour autorité d’intervenir en ce domaine et dans un autre point, le code de la famille (1972) étaient susceptibles d’apporter des modifications très importantes dans le domaine de l’attribution des terres et des règles d’héritages.
D’ailleurs, les autorités Sénégalaises mirent de grands espoirs dans cette réforme comme en témoigne la citation suivante : « cette réforme doit réactiver le principe communautaire, base de l’éthique de la nation une des composante de la négritude » (Senghor 1961 : 138). Cette nouvelle législation respectant la tradition africaine a complètement exclu de l’arsenal foncier la notion de propriété telle qu’elle figurait dans le code civil français de 1830. En effet, la réforme était un exemple de droit négro africain parce que l’État devrait reprendre la fonction des anciens lamanes et déléguer ensuite cette fonction à des « instances locales élues » . C’est pourquoi les terres constituées par les zones de terroirs seront dorénavant gérées par l’organe délibérant de la communauté rurale conformément au décret 80-1051 du 14 octobre 1980 modifiant certains éléments du décret 72-1288 du 27 octobre 1972 relatifs aux conditions d’affectation et de désaffectation des terres du domaine national. En somme en la matière, compétence est donnée aux élus locaux d’affecter et de désaffecter ces terres après approbation de l’autorité de tutelle. Cette situation sera à l’origine de la mise en place progressive de la décentralisation afin d’accompagner le processus.
Faut-il rappeler qu’avant cette loi 72-25 portant création des communautés rurales, l’État avait mis en place des sections rurales par le décret 66. La section rurale est définit selon l’article 2 de ce décret comme étant : « constituée par un ensemble homogènes de terres nécessaires au développement de la population du ou des villages qui y sont implantés y ayant des intérêts ruraux communs ». Dépourvue de la personnalité juridique, elle était administrée par un comité rural et un président chargés de gérer les terres du domaine national sises dans le périmètre de la section rurale sous le contrôle des autorités définies à l’article 3 dudit décret. Cependant la section rurale va disparaître avec la création des communautés rurales, nouvelles structures de prise en charge des affaires locales vu sa composition matérielle et ses organes institutionnels. Aux termes des dispositions générales de la loi 72 :
La communauté rurale est une personne morale de droit public dotée de l’autonomie financière. Ses organes représentatifs sont le conseil rural et le président du conseil rural qui exercent en son sein les attributions définies par la présente loi.
Ainsi les organes locaux de la communauté rurale et plus particulièrement le Président du conseil rural, seront chargés d’affecter et de désaffecter les terres du domaine national situant dans leur terroir conformément au décret 72-1288 du 27 octobre 1972 relatif aux conditions d’affectation et de désaffectation des terres du domaine national.
Toutefois une modification de taille interviendra avec le nouveau dispositif de 1996 portant code des collectivités locales au Sénégal. Il s’agissait en effet pour les autorités de cette époque d’approfondir la décentralisation en érigeant la région en collectivité locale et par la même occasion procéder à une responsabilité plus accrue des collectivités décentralisées par le transfert de neuf (9) domaines de compétences aux trois ordres de collectivités, à savoir la région, la commune et la communauté rurale.
Aujourd’hui, comment les collectivités locales, particulièrement les communautés rurales gèrent-elles le domaine national ainsi que les conflits qui peuvent survenir ? La prégnance du pluralisme juridique n’est elle pas un blocage à une bonne application du droit de la terre et d’une bonne gestion des conflits au regard des principes modernes de gestion étatique ? Ces interrogations reposent la question centrale qui est de savoir si le système traditionnel de la gestion des terres est toujours en vigueur en dépit des règles du droit positif. Cela revient à s’interroger sur le degré d’effectivité de la loi sur le Domaine national dans les collectivités décentralisées à l’aune d’une réforme en cours. Pour cerner cette problématique, nous proposons de l’aborder sous deux axes : d’abord, nous exposerons le caractère dualiste du régime de gestion des terres du domaine nationale (I) et enfin, nous verrons les modes de règlements des conflits fonciers (II).
I. Un régime dualiste de gestion des terres du domaine national
Le régime foncier sénégalais présente un double volet traditionnel et moderne. Ce dualisme juridique justifie d’une part la survivance du système foncier traditionnel (A.) et d’autre part l’existence d’une gestion des terres conformément au droit positif (B.).
A. Une survivance d’un système foncier traditionnel
Ce système foncier obéit à une certaine organisation et repose sur un ensemble de règles qui déterminent son fonctionnement. L’organisation traditionnel du foncier fait ressortir deux catégories juridiques qui conditionnaient l’accès à la terre : il s’agit des droits fonciers principaux ou encore des méthodes indirectes (Lericollais 1999 : 668) de faire valoir. Les droits fonciers principaux sont nombreux et variés, mais nous en retiendrons deux : il s’agit du droit de feu et du droit de hache.
Dans le système foncier traditionnel sénégalais, l’un des principes qui gouvernent les modes d’occupation de la terre est le principe de la découverte (Niang 1984). La découverte est le premier acte qui consacre l’occupation d’une terre. Ce procédé s’effectue chez les Sérères d’abord par le feu (o njaay) (Pélissier 1996 : 939). Le procédé de feu consiste à délimiter sur un espace donné une surface cultivable dont le territoire a été circonscrit par un incendie de trois, quatre ou six jours. A partir de ce moment l’acte est créateur de droit, et le titulaire s’affirme comme premier occupant du sol. L’auteur du premier acte d’occupation du sol est appelé lamane ou borom day ou o yaalo njaa. Il est le seul maître de sa terre qu’il met à la disposition de sa famille dont les membres peuvent bénéficier du droit d’exploitation ou de culture temporaire. De ce fait, le borom day est le premier à mettre la terre en positon d’être exploitée, ce qui lui donne un droit puissant et effectif. L’origine des lamanats dans la communauté rurale de Fissel (communauté rurale Sérère) est différente de celle de droit de feu accordé par le Bour dans le Sine. En effet, en l’absence d’un roi équivalent au Bour, les lamanats de Fissel se sont constitués d’eux mêmes : « le premier homme arrive dans la brousse non encore défrichée et construit sa case et fait son feu de brousse sans rien demander […] chacun pouvant faire son feu comme il l’entendait » .
Les premiers défricheurs furent donc les premiers lamanes, venus bien avant l’arrivée des blancs et l’installation des chefs de canton. Les auteurs qui ont étudié les modes d’occupation des sols s’accordent pour admettre qu’il y a eu antériorité de défrichement par le feu. Dans la zone qui a fait l’objet de nos investigations (zone sérère), toutes les versions s’accordent pour attester l’existence de cette première forme de possession des terres. Cette première conquête par le feu confère au lamane le pouvoir de gérer le patrimoine foncier ainsi conquis par sa communauté dont il est, par son statut social au sein de la collectivité, le dépositaire, donc le responsable devant les hommes et les ancêtres. Une précision mérite d’être apportée à cet effet dans la mesure où les paysans continuent de faire encore la différence entre lamane-sakh : chef de village et lamane-lanké : chef de terres. A côté de ce droit de feu, on note l’existence du droit de hache qui confère à son titulaire un véritable droit d’accès à la terre.
Les terres les plus anciennement cultivées ont été réparties entre les patrimoines parfois très vastes relevant des premiers occupants. Mais ceux-ci n’utilisent effectivement qu’une partie de leurs terres, celles qu’ils étaient en mesure de défricher et où ils se comptaient en propriétaires exploitants. Cela signifie que les terres sur lesquelles ils ne cultivaient pas, les lamanes accordaient le « droit de hache » (Lericollais 1999 : 668) en concédant le droit de culture aux paysans qu’ils agréent pour défricher. Ce droit de hache (gaajo) ou (semign) chez les Wolofs ou (baakh) chez les Sérères est le droit issu des rapports personnels entre le premier occupant qui a délimité par le feu et le second qui tient son titre de l’instrument par lequel il a défriché la terre. Le détenteur de la hache possède un droit se transmettant de père en fils. Il en est ainsi dans la mesure où aussi longtemps que le maître de hache borom ngadio s’acquitte des obligations (Lericollais 1999 : 668) coutumières à l’égard du maître de feu, son droit de culture est imprescriptible et héréditaire.
Outre la redevance annuelle et généralement symbolique (une gerbe de mil par exemple) versée pour chaque champ occupé, les obligations du borom ngadio envers le borom daay prennent une importance et une solennité particulière au moment de la mort du lamane et l’entrée en fonction de son successeur. Il en va de même lorsqu’un paysan devenant chef de famille hérite, avec le patrimoine paternel, le droit de hache. Dans les deux cas, l’hommage à un nouveau lamane ou la reconnaissance du droit émanant du maître de feu par un paysan nouvellement investi du droit de hache entraîne un don important tel qu’un grenier de mil ou une tête de bétail. Cependant, il est à noter que de telles redevances ne représentent pas dans leur essence une rente foncière, même si elles ont pris ultérieurement le caractère ; elles traduisent naguère une hiérarchie, des liens de dépendance d’homme à homme liés à une situation sociopolitique. Droit généralement accordé aux catégories sociales exclues du contrôle de la terre, il permet de faire ressortir le caractère communautaire des biens dans la société Sérère qui doivent permettre à ses différentes composantes de pouvoir survivre.
A côté des droits fonciers principaux, on note aussi l’existence d’autres voies juridiques susceptibles de permettre aux autres habitants de cette localité de pouvoir jouir pleinement des fruits provenant de l’usage de la terre. Ces droits fonciers dérivés les plus usités sont principalement le prêt d’une part et d’autre part la location. Dans la communauté rurale de Fissel, l’appartenance directe ou indirecte à la société confère un droit d’usage automatique. Mais le droit d’usage peut être attribué sous forme de prêt (Crousse / Le Bris / Le Roy 1986 : 426), gratuit ou onéreux. Le prêt est un « contrat par lequel une des parties, le prêteur, remet à un autre, l’emprunteur, une chose dont ce dernier pourra user, à charge de la restituer, en nature ou par équivalent » . Le droit d’usage direct est celui exercé par les descendants, membres authentiques de la communauté. Quant à l’usage indirect, il correspond généralement au prêt qui peut revêtir deux formes.
S’agissant du prêt conditionné ou onéreux, il convient de le distinguer de la location. En effet, si le premier met en lumière un mode de répartition des terres et aussi les rapports sociaux, le second qui est la recherche du profit et de l’investissement sur la terre ne crée pas lui aussi des rapports capitalistes, ayant la terre comme support. Le prêt onéreux, contrairement au prêt gratuit, est un contrat synallagmatique, assortit de certaines conditions et redevances. Les contreparties ne sont jamais en espèces mais en nature ou en prestation de travail. On peut définir la redevance foncière comme un droit matériel ou non, perçu sur la terre en raison du statut de l’exploitant, ou en raison d’un contrat entre le maître foncier et l’exploitant. Caverivière et Debène ont affirmé que la redevance était symboliquement versée sous forme de gerbes de mil. Mais cette redevance est actuellement financière dont l’emprunteur est tenu de verser au propriétaire du lopin de terre en guise de reconnaissance de l’existence de relation contractuelle entre eux. En cas de cessation du prêt soit sur initiative du maître foncier soit sur celle de l’emprunteur, obligation est faite au premier de reverser la redevance de quelque nature qu’elle soit au détenteur temporaire du droit d’usage. Le prêt sans condition ou prêt gratuit ne prévoit aucune redevance dans la mesure où il se fonde sur la solidarité et l’assistance mutuelle. Il est perçu comme étant un droit d’exploitation d’un lopin de terre accordé par un maître foncier à un individu. Il se fait au profit d’amis, de parents, d’anciens captifs surtout et d’étrangers.
De nos jours, les prêts de terres sont devenus tournants. L’emprunteur ne fait jamais plus qu’une saison sur une même terre. Ce phénomène s’explique par le fait que celui-ci ne pourra en aucun cas se prévaloir du temps qu’il a exploité la terre pour devenir au nom de la loi sur le domaine national le propriétaire du droit d’usage au détriment du véritable détenteur du droit foncier principal. De manière plus claire, on constate que les prêts de terres sur une longue période, de même que la possibilité de faire certains actes sont réglementés de sorte que l’emprunteur, en cas de conflits, ne puisse se prévaloir d’une mise en valeur au bout de deux années pour se faire affecter les sols. En dehors du prêt, certaines couches dépourvues de terres peuvent aussi recourir à la location pour jouir pleinement des ressources foncières.
Les modes d’occupation traditionnels de la terre, conjugués à la situation du monde rural marqué par une dégradation sans précédent des ressources naturelles intimement liée à une densification de la population rurale posent un certain nombre de problèmes relatifs à l’accès aux biens fonciers. Un tel phénomène a conduit l’adoption d’un certain nombre de méthodes par lesquelles les exploitants ont la possibilité d’accéder à la terre une fois qu’ils acceptent de se conformer à la tradition. La location de la terre, bien étant une pratique formellement interdite par la loi, demeure être monnaie courante dans cette localité et permet à certaines catégories d’individus de pouvoir survivre grâce aux ressources tirées de la terre. Cette pratique découle du principe de base qui régit le droit foncier traditionnel et qui repose sur l’idée selon laquelle « la terre n’est pas un bien accumulable mais un moyen de survie et de production du groupe social et de ses éléments constitutifs » (Crousse / Le Bris / Le Roy 1986 : 426). A cette fin, le droit d’usage de la terre doit être assuré à tous les membres de la communauté dans le présent comme dans la future avec l’obligation pour les allochtones surtout de verser une contrepartie ; la nature et les formes de celle-ci sont variables selon les cas.
La pratique qui consiste pour un exploitant de payer une redevance en espèce ou nature en contrepartie de la mise en valeur d’un lopin de terre appartenant à un maître foncier, est temporaire (Deville / Toulmin / Traoré 2000) et s’éteint en général après la phase des récoltes. De ce fait, la location ne confère plus à son titulaire un droit d’usage à long terme. Les transformations des relations entre les locataires de terres et les maîtres fonciers procèdent de la prudence de ces derniers. En effet, la location de terres sur une durée relativement longue a permis à pas mal d’exploitants au moment de l’entrée en vigueur de la loi sur le domaine national de se reconvertir en de véritables maîtres fonciers des terres, objet de location. Cette loi a conféré à ces exploitants des droits d’usage ne pouvant plus être révoqués et se transmettant de génération en génération au détriment du lamane et a animé de vives querelles au sein de cette localité et ces litiges perdurent dans le temps. En somme, on aperçoit visiblement à travers le régime foncier traditionnel, une véritable organisation concernant les modes d’accès à la terre. Une telle organisation est néanmoins assortie d’un certain nombre de règles qui déterminent son fonctionnement.
Les règles qui régissent le fonctionnement du foncier traditionnel sont relatives d’une part aux modes d’acquisition des droits sur la terre (souvent par héritage), selon un régime patrilinéaire. Chez les Sérères, la transmission (Lericollais 1999 : 668) de père en fils des droits de hache est fréquente en principe. Elle a lieu si le premier défricheur ait opéré indépendamment des membres de sa famille maternelle avec la seule aide de ses fils ou lorsqu’il s’agit d’un défrichement récent, donc l’acquisition d’un bien personnel normalement transmis de père en fils.
Dans le système traditionnel, la terre est d’abord un bien lignagère (Lericollais 1999 : 668). Elle appartient à une communauté parentale à la tête de laquelle se trouve un responsable qui est à ce titre le gérant en matière foncière parce qu’étant le digne hérité du titulaire du droit foncier originaire. A cet effet en cas de décès du responsable, le caractère indivis demeure et la succession revient toujours à l’aîné (Lericollais 1999 : 668). C’est pourquoi, les titulaires du droit de hache ou leurs héritiers pour continuer à exercer leurs droits sur les terres concédées doivent en cas de décès du lamane s’acquitter des obligations coutumières.
L’accomplissement de ce rituel permet de maintenir les relations entre le maître foncier et le titulaire de droit de hache au beau fixe et aussi longtemps que le maître de hache borom-ngadio honore ce lien, son droit de culture est imprescriptible et héréditaire. Dans cette même ordre d’idées Paul Pélissier (1996 : 32) nous apprend que :
L’ancienneté des droits fonciers dans le Cayor, le Baol, et une partie du Djolof, est attestée par la survivance de l’appropriation de nombreuses terres à des « Lamanes » dont les droits remontent à l’époque du peuplement Sérère et une plus grande partie du terroir Sérère appartient à des « Lamanes ».
Toutefois, même si ce système de transmission des droits sur la terre est dominant, force est de constater que les droits fonciers peuvent s’acquérir de manière matrilinéaire. Dans la société traditionnelle, la transmission des droits se fait en général de manière patrilinéaire (Niang 1984), c’est-à-dire de père en fils. Cependant, il convient de préciser que même si la dévolution patrilinéaire des terres lignagères a été d’emblée un mode quantitativement dominant, du moins dans cette localité, il n’en demeure pas moins que le système matrilinéaire (Niang 1984) continue de s’ériger en une exception et permet de ce fait aux ayants droits d’acquérir des prérogatives foncières.
B. Une timide application de la LDN par les collectivités locales
L’application de la loi sur le domaine national fait ressortir le véritable pluralisme juridique dans lequel baigne le droit sénégalais surtout en matière foncière. En effet, la réalité permet de constater que même si c’est la loi qui devait primer sur les modes d’accès traditionnels, la forte présence des règles locales dans les modes de gestion annihile les efforts de l’État dans sa politique de moderniser le droit foncier. Bien qu’étant simple au regard de la loi, l’application de la procédure d’affectation des terres par le conseil rural demeure loin d’être une chose aisée, et ce phénomène produit un certain nombre d’effets qu’il faudra préciser.
La procédure d’affectation des terres du domaine national comporte deux éléments : d’abord l’introduction d’une demande d’affectation de terres par l’intéressé auprès du conseil rural puis une délibération par celui-ci suivie d’une approbation du Représentant de l’État. A ce titre la loi a clairement prévu que tout citoyen désirant occuper une parcelle du domaine national doit formuler une demande d’affectation adressée à l’organe de décision de la collectivité locale et attendre la notification de l’acte affectataire. Le demandeur doit alors justifier sa « capacité de mettre en valeur » la superficie demandée. Autrefois, cette demande était adressée au Président du conseil rural mais de nos jours elle est adressée au conseil rural. L’affectation d’une terre du domaine national est prononcée par délibération après examen de la demande reçue, afin d’apprécier les capacités d’exploitation du demandeur ainsi que de la disponibilité de la terre. A cet effet, la collectivité peut donner mission à sa commission domaniale de procéder à l’enquête sur le terrain et de formuler ainsi un avis pour éclairer la décision de l’organe délibérant. Ces dispositions s’appliquent aussi bien aux hommes qu’aux femmes. En outre, en vertu du contrôle de légalité, les actes relatifs au foncier sont transmis au Représentant de l’État pour approbation sans laquelle ils ne seront pas exécutoires.
Au regard des règles qui gouvernent cette procédure, elles se caractérisent surtout par leur simplicité. Ainsi les autorités locales ne devraient en cas se confronter à des problèmes pour leur application. Cependant, en réalité ces autorités rencontrent des difficultés pour appliquer à la lettre ces dispositions. Ces difficultés sont inhérentes aux pratiques locales encore fortement dominées par la tradition. En effet, la gestion traditionnelle est privilégiée par les populations avec une complicité partagée par les demandeurs et les détenteurs de terres. Malgré l’avènement de la loi sur le domaine national qui confie la gestion des terres au conseil rural, la gestion coutumière est toujours en vigueur dans les villages. Au niveau de chaque carré, la gestion des terres est sous l’autorité du chef de famille pour la distribution infra familiale. Avant l’entrée en vigueur de la loi sur le domaine national, il revenait au « Lamane » en tant qu’administrateur des biens fonciers de la communauté la tâche de la répartition des terres en vertu du principe communautaire, socle de la solidarité rurale. Il était donc chargé d’affecter et de les repartir les terres entre collectivités familiales chargées de les exploiter. En effet, le modèle traditionnel des terres était caractérisé par cinq (Chabbas 1965) éléments fondamentaux :
• la terre est un bien collectif à la disposition de toute la communauté ;
• la terre est gérée par un administrateur dans l’intérêt de la communauté ;
• le droit de mettre en valeur la terre est assuré à toute personne de la communauté ;
• la terre est un bien inaliénable ;
• la terre est sous le contrôle des puissances sacrées et Dieu.
Au demeurant, une précision des effets de l’application du décret relatif à l’affectation et à la désaffectation permettrait une meilleure compréhension des nouveaux rapports entre les anciens maîtres fonciers et les actuels gouvernants locaux. En réalité, les changements induits par le décret d’application de la loi sur le domaine national ont été mal perçus à travers le monde rural. Il en est ainsi dans la mesure où l’introduction de cette loi dans les campagnes a eu comme conséquence un bouleversement de l’organisation sociale (Faye 2008 : 20) traditionnelle par la mise en place de nouvelles élites ayant compétence pour administrer les biens fonciers. Ces innovations mal accueillies par les ruraux, continuent d’animer les rivalités entre forces traditionnelles et autorités locales et justifient par voie de conséquence les raisons principales de l’échec de la réforme foncière. Ces conflits de pouvoirs entre les chefs coutumiers, responsables de la gestion des terres et les autorités légalement investies par l’État sont au cœur des manquements relatifs à l’application de cette réforme foncière.
Il existe aussi d’autres facteurs toujours endogènes qui empêchent à ces autorités de pouvoir respecter la procédure d’affectation. Ceux-ci tiennent au fait que la plupart des élus sont généralement issus des familles lamanales ou proches d’elles et bénéficient également de leur suffrage. De ce fait, ces liens peuvent constituer véritablement un frein pour ces élus lorsqu’ils seront appelés à prendre des décisions susceptibles de causer des désagréments aux organes traditionnels. En d’autres termes, le conseil rural est donc impérativement tenu de prendre en compte les intérêts de ces groupes de pression que représentent les chefs de terres dans l’exercice de leurs prérogatives foncières. De plus, dans une société fortement ancrée à la tradition la réaffectation de terres antérieurement exploitées par une personne à une autre peut constituer un début de conflits. Par ailleurs, les organes locaux se trouvent également devant une situation d’impasse juridique liée au fait que les textes n’ont pas définis avec clarté les critères relatifs à l’affectation des terres du domaine national. Les critères relatifs à l’affectation des terres du domaine national n’ont pas fait l’objet d’une définition claire par le législateur. Cette imprécision affecte aussi bien le critère de résidence que celui de la mise en valeur.
Le conseil rural commence véritablement à user de ses prérogatives en matière de désaffectation des terres du domaine national. Néanmoins, de telles prérogatives sont difficiles à mettre en œuvre malgré la simplicité de la procédure à adopter à cet effet. La complexité de la désaffectation des terres du domaine national tient au fait que l’insuffisance de mise en valeur de la terre comme motif de désaffectation n’est pas encore une réalité. L’affectation d’une parcelle du domaine national suppose que l’affectataire soit en mesure de la mettre en valeur. A cet effet, le décret nº 72-1288 à travers son article 3 alinéa 2 précise que : « l’affectation est prononcée en fonction de la capacité des bénéficiaires d’assurer, directement ou avec l’aide de leur famille la mise en valeur de ces terres conformément au programme établi par le conseil rural ». A la lecture de cet article, il ressort l’idée selon laquelle, si la capacité de mise en valeur est une condition d’affectation des terres du domaine national, la logique voudrait que la non mise en valeur ou l’insuffisance d’une mise en valeur soit une condition de désaffectation de ces terres. C’est du moins ce que l’article 9 du décret de 72-1288 semble énoncer quand il prévoit qu’une « […] insuffisance de la mise en valeur […] » peut être une cause de désaffectation totale ou partielle.
Généralement, l’insuffisance de mise en valeur est retenue lorsqu’au bout d’un délai bien déterminé (généralement de 2 ans) et notifié à l’affectataire, celui-ci n’arrive pas à exploiter la parcelle qu’on la octroyé. Les autorités locales dans l’exercice de cette compétence ont souvent des problèmes pour apprécier ce qu’est effectivement l’insuffisance de la mise en valeur. En plus, la loi semble imposer au conseil rural une obligation de motivation de la décision de désaffectation qui serait prise sur la base d’un défaut de mise valeur, en décidant qu’ « à défaut d’un tel arrêté (préfectoral) le conseil rural ne saurait se contenter dans sa décision du simple motif d’insuffisance de mise en valeur sans préciser en quoi cette carence serait reprochée à l’affectataire ». C’est le sens de la décision de la Cour Suprême du 25 mars 1981 affaire El Hadji Massamba Fall contre État du Sénégal. Cela justifie le laxisme des autorités locales du moment où elles seront toujours appelées à fournir les éléments sur la base desquels ils se sont fondés pour désaffecter une terre relevant du domaine national au motif du défaut de mise en valeur ou son insuffisance.
Dans la pratique, les conseils ruraux abordent les délais de mise en valeur d’une manière uniforme de deux années sans compter de l’envergure des projets ni la capacité personnelle et financière des affectataires. Mais ce délai de deux ans qui n’est pas prévu par aucun texte pose un autre problème et a des effets directs sur la qualification de la mise en valeur par les Conseils ruraux : à partir de quand commence t-il à courir ? Au jour de la délibération, au jour de la délimitation ou au jour de la délibération par le sous-préfet ? Les investigations menées dans cette localité mettent en exergue que le conseil rural n’a jamais désaffecté une terre du domaine national pour motif d’une insuffisance de mise en valeur par l’affectataire. L’explication de cet amateurisme peut être liée au fait que les superficies les plus importantes sont affectées aux hommes d’affaires ou aux marabouts qui ont présentés des projets insusceptibles d’être finalisés dans un délai de deux ans et qui participeraient dès leur réalisation au développement de la localité. Par ailleurs, les terres affectées pour des motifs agricoles, pastorales ou à l’habitat souffrent rarement d’une insuffisance de mise en valeur dans la mesure où elles visent à satisfaire souvent des besoins immédiats et par conséquent sont utilisées par les bénéficiaires dès l’acte de notification. En outre, même si on remarque que l’insuffisance de la mise en valeur est rarement mise en branle par le conseil rural pour procéder à une désaffectation des terres du domaine national, il est tout de même fréquent de voir ce conseil rural désaffecter certaines terres pour d’autres raisons prévues par la loi (intérêt général).
Abdoul Aziz Sow
Docteur d’Etat en Droit Public
Expert Foncier
Introduction
La décentralisation constitue un paradoxe en matière de gestion des conflits fonciers : parce qu’en elle-même, elle porte les germes des conflits qu’elle prétend pourtant gérer. Au lieu de les minimiser, elle tend au contraire à les multiplier. Telle n’a pourtant pas été la volonté initiale du législateur sénégalais lorsqu’il votait les lois 96-06 et 96-07 du 22 mars 1996 portant Code des Collectivités locales. D’ailleurs, la loi 64-46 du 17 juin 1964 sur le Domaine Nationale a pourtant été initiée pour régler définitivement les malentendus, sources de conflits en matière de gestion du foncier. Dans l’esprit de ses initiateurs, comme dans celui de ceux qui l’ont soutenu, la décentralisation est un idéal pour une bonne gouvernance, autrement dit, une meilleure chance accordée aux collectivités locales afin qu’elles deviennent des actrices et des gestionnaires du développement à la base, et non de simples gérants des politiques toujours centralisées. En effet, l’attitude du gestionnaire du développement doit lui permettre de faire face aux mutations qui s’opèrent à tous les niveaux. Ces mutations s’accordent avec des revendications de plus en plus pressantes et pertinentes des couches populaires, véritables acteurs du monde rural, qui naguère étaient étouffées tant sur le plan politique qu’économique (les paysans, les éleveurs, les associations de développement etc.). La gestion du foncier, dont l’affectation revient désormais aux communautés rurales est hautement conflictuelle : parce que les enjeux sont nombreux et difficiles à maîtriser.
Les différents blocages présentés dans les récents rapports sur l’évolution de la décentralisation laissent entrevoir une augmentation de ces tensions, parce que les potentialités de conflit, quand on aborde la question sous l’angle du droit et de l’anthropologie, sont telles qu’on peut se laisser aller au pessimisme. Les conflits existants sont connus, mais ceux résultant de la gestion du foncier semblent être les plus importants et les plus dangereux et justifient notre problématique.
Cependant, on ne peut parler du système juridique Sénégalais en ignorant deux grandes étapes intimement liées : il s’agit de la loi sur le domaine national et des textes sur le droit de la décentralisation. Ces deux axes constituent des étapes charnières au droit Sénégalais, dans la mesure où elles vont lui imprimer. Il faut rappeler que les puissances coloniales avaient mis en place dans les territoires conquis un ensemble de mécanismes visant à asseoir leur politique dans les domaines économiques, sociaux, culturels et politiques. Ainsi, en matière foncière, elles avaient édicté une réglementation qui reposait sur le code civil. Ce dernier favorisant la mise en place d’un système des inscriptions, leur permettait de s’approprier les terres dites vacantes et sans maître. Par la suite elles avaient édicté des lois et règlements successifs susceptibles de garantir leur mainmise sur les ressources naturelles en général et la terre plus particulièrement. Cette conception foncière a connu un âge d’or tout au long de l’époque coloniale avant de faire l’objet d’une remise en cause suite à l’accession des États africains à la souveraineté internationale qui leur offrait désormais l’aptitude de prendre en charge leurs propres affaires et de présider la destinée de leurs peuples. Ces acquis post-coloniaux ont été consolidés par certains principes proclamés par les instances internationales et qui devraient désormais régir les rapports entre les Etats. Parmi ces principes, on avait celui relatif « à la non- immixtion ou la non ingérence dans les affaires intérieures des États » , aboutissement logique de l’autre principe du « droit des peuples à disposer d’eux-mêmes ».
Ce contexte nouveau permettra rapidement aux jeunes Etats africains de se pencher avec minutie sur le legs colonial en vue de l’adapter à leur contexte. C’est dans ce sillage que s’inscrit l’action de ces États qui consistait à mettre en place un dispositif juridique ayant pour finalité une réadaptation du système foncier colonial à leurs propres réalités. Les différentes réformes foncières et agraires initiées à cet effet par les nouveaux dirigeants africains en sont une parfaite illustration. En effet, pour les États et les Administrations, la terre est un bien, un bien économique à mettre en valeur pour produire plus et pour réaliser le développement. Cette rupture d’avec la politique foncière coloniale avait pour soubassement une conception spécifiquement africaine reposant sur « la voie africaine du socialisme » qui mettait en exergue l’aspect communautaire et non individuel des formes de propriété, notamment dans les campagnes. C’est la raison pour laquelle la plupart des États du Sahel ont affirmé leur monopole sur la propriété de la terre, se posant à la fois comme héritiers modernes des anciens lamanes (chefs de terres) et comme des capitaines qui doivent mener le bateau de « modernisation » à bon port, par des textes de lois. André Peytavin, Ministre des finances disait dans l’exposé des motifs de la loi sur le domaine national dès 1959, qu’il fallait « mettre fin à une organisation foncière archaïque, de forme féodale ou seigneuriale » .
C’est dans ce cadre que le Sénégal avait décidé d’entreprendre dès le lendemain de son indépendance en 1960 une politique de décentralisation qui devait déboucher irréversiblement à la mise en place de nouvelles structures par des réformes susceptibles de permettre effectivement aux citoyens habitant un même espace géographiquement déterminé d’être impliqués et de s’impliquer dans la gestion des affaires de leur localité. En effet, depuis l’indépendance l’importance des droits coutumiers est reconnue par les anthropologues mais elle a été longtemps considérée comme une catégorisation juridique à laquelle devait se substituer un droit positif de type moderne. Cette tendance a dominé toutes les législations foncières des pays francophones. Parmi les mesures prises par le Sénégal en la matière afin d’améliorer l’utilisation de l’espace cultivé, la loi sur le domaine national (1964), la constitution des communautés rurales (1972) ayant pour autorité d’intervenir en ce domaine et dans un autre point, le code de la famille (1972) étaient susceptibles d’apporter des modifications très importantes dans le domaine de l’attribution des terres et des règles d’héritages.
D’ailleurs, les autorités Sénégalaises mirent de grands espoirs dans cette réforme comme en témoigne la citation suivante : « cette réforme doit réactiver le principe communautaire, base de l’éthique de la nation une des composante de la négritude » (Senghor 1961 : 138). Cette nouvelle législation respectant la tradition africaine a complètement exclu de l’arsenal foncier la notion de propriété telle qu’elle figurait dans le code civil français de 1830. En effet, la réforme était un exemple de droit négro africain parce que l’État devrait reprendre la fonction des anciens lamanes et déléguer ensuite cette fonction à des « instances locales élues » . C’est pourquoi les terres constituées par les zones de terroirs seront dorénavant gérées par l’organe délibérant de la communauté rurale conformément au décret 80-1051 du 14 octobre 1980 modifiant certains éléments du décret 72-1288 du 27 octobre 1972 relatifs aux conditions d’affectation et de désaffectation des terres du domaine national. En somme en la matière, compétence est donnée aux élus locaux d’affecter et de désaffecter ces terres après approbation de l’autorité de tutelle. Cette situation sera à l’origine de la mise en place progressive de la décentralisation afin d’accompagner le processus.
Faut-il rappeler qu’avant cette loi 72-25 portant création des communautés rurales, l’État avait mis en place des sections rurales par le décret 66. La section rurale est définit selon l’article 2 de ce décret comme étant : « constituée par un ensemble homogènes de terres nécessaires au développement de la population du ou des villages qui y sont implantés y ayant des intérêts ruraux communs ». Dépourvue de la personnalité juridique, elle était administrée par un comité rural et un président chargés de gérer les terres du domaine national sises dans le périmètre de la section rurale sous le contrôle des autorités définies à l’article 3 dudit décret. Cependant la section rurale va disparaître avec la création des communautés rurales, nouvelles structures de prise en charge des affaires locales vu sa composition matérielle et ses organes institutionnels. Aux termes des dispositions générales de la loi 72 :
La communauté rurale est une personne morale de droit public dotée de l’autonomie financière. Ses organes représentatifs sont le conseil rural et le président du conseil rural qui exercent en son sein les attributions définies par la présente loi.
Ainsi les organes locaux de la communauté rurale et plus particulièrement le Président du conseil rural, seront chargés d’affecter et de désaffecter les terres du domaine national situant dans leur terroir conformément au décret 72-1288 du 27 octobre 1972 relatif aux conditions d’affectation et de désaffectation des terres du domaine national.
Toutefois une modification de taille interviendra avec le nouveau dispositif de 1996 portant code des collectivités locales au Sénégal. Il s’agissait en effet pour les autorités de cette époque d’approfondir la décentralisation en érigeant la région en collectivité locale et par la même occasion procéder à une responsabilité plus accrue des collectivités décentralisées par le transfert de neuf (9) domaines de compétences aux trois ordres de collectivités, à savoir la région, la commune et la communauté rurale.
Aujourd’hui, comment les collectivités locales, particulièrement les communautés rurales gèrent-elles le domaine national ainsi que les conflits qui peuvent survenir ? La prégnance du pluralisme juridique n’est elle pas un blocage à une bonne application du droit de la terre et d’une bonne gestion des conflits au regard des principes modernes de gestion étatique ? Ces interrogations reposent la question centrale qui est de savoir si le système traditionnel de la gestion des terres est toujours en vigueur en dépit des règles du droit positif. Cela revient à s’interroger sur le degré d’effectivité de la loi sur le Domaine national dans les collectivités décentralisées à l’aune d’une réforme en cours. Pour cerner cette problématique, nous proposons de l’aborder sous deux axes : d’abord, nous exposerons le caractère dualiste du régime de gestion des terres du domaine nationale (I) et enfin, nous verrons les modes de règlements des conflits fonciers (II).
I. Un régime dualiste de gestion des terres du domaine national
Le régime foncier sénégalais présente un double volet traditionnel et moderne. Ce dualisme juridique justifie d’une part la survivance du système foncier traditionnel (A.) et d’autre part l’existence d’une gestion des terres conformément au droit positif (B.).
A. Une survivance d’un système foncier traditionnel
Ce système foncier obéit à une certaine organisation et repose sur un ensemble de règles qui déterminent son fonctionnement. L’organisation traditionnel du foncier fait ressortir deux catégories juridiques qui conditionnaient l’accès à la terre : il s’agit des droits fonciers principaux ou encore des méthodes indirectes (Lericollais 1999 : 668) de faire valoir. Les droits fonciers principaux sont nombreux et variés, mais nous en retiendrons deux : il s’agit du droit de feu et du droit de hache.
Dans le système foncier traditionnel sénégalais, l’un des principes qui gouvernent les modes d’occupation de la terre est le principe de la découverte (Niang 1984). La découverte est le premier acte qui consacre l’occupation d’une terre. Ce procédé s’effectue chez les Sérères d’abord par le feu (o njaay) (Pélissier 1996 : 939). Le procédé de feu consiste à délimiter sur un espace donné une surface cultivable dont le territoire a été circonscrit par un incendie de trois, quatre ou six jours. A partir de ce moment l’acte est créateur de droit, et le titulaire s’affirme comme premier occupant du sol. L’auteur du premier acte d’occupation du sol est appelé lamane ou borom day ou o yaalo njaa. Il est le seul maître de sa terre qu’il met à la disposition de sa famille dont les membres peuvent bénéficier du droit d’exploitation ou de culture temporaire. De ce fait, le borom day est le premier à mettre la terre en positon d’être exploitée, ce qui lui donne un droit puissant et effectif. L’origine des lamanats dans la communauté rurale de Fissel (communauté rurale Sérère) est différente de celle de droit de feu accordé par le Bour dans le Sine. En effet, en l’absence d’un roi équivalent au Bour, les lamanats de Fissel se sont constitués d’eux mêmes : « le premier homme arrive dans la brousse non encore défrichée et construit sa case et fait son feu de brousse sans rien demander […] chacun pouvant faire son feu comme il l’entendait » .
Les premiers défricheurs furent donc les premiers lamanes, venus bien avant l’arrivée des blancs et l’installation des chefs de canton. Les auteurs qui ont étudié les modes d’occupation des sols s’accordent pour admettre qu’il y a eu antériorité de défrichement par le feu. Dans la zone qui a fait l’objet de nos investigations (zone sérère), toutes les versions s’accordent pour attester l’existence de cette première forme de possession des terres. Cette première conquête par le feu confère au lamane le pouvoir de gérer le patrimoine foncier ainsi conquis par sa communauté dont il est, par son statut social au sein de la collectivité, le dépositaire, donc le responsable devant les hommes et les ancêtres. Une précision mérite d’être apportée à cet effet dans la mesure où les paysans continuent de faire encore la différence entre lamane-sakh : chef de village et lamane-lanké : chef de terres. A côté de ce droit de feu, on note l’existence du droit de hache qui confère à son titulaire un véritable droit d’accès à la terre.
Les terres les plus anciennement cultivées ont été réparties entre les patrimoines parfois très vastes relevant des premiers occupants. Mais ceux-ci n’utilisent effectivement qu’une partie de leurs terres, celles qu’ils étaient en mesure de défricher et où ils se comptaient en propriétaires exploitants. Cela signifie que les terres sur lesquelles ils ne cultivaient pas, les lamanes accordaient le « droit de hache » (Lericollais 1999 : 668) en concédant le droit de culture aux paysans qu’ils agréent pour défricher. Ce droit de hache (gaajo) ou (semign) chez les Wolofs ou (baakh) chez les Sérères est le droit issu des rapports personnels entre le premier occupant qui a délimité par le feu et le second qui tient son titre de l’instrument par lequel il a défriché la terre. Le détenteur de la hache possède un droit se transmettant de père en fils. Il en est ainsi dans la mesure où aussi longtemps que le maître de hache borom ngadio s’acquitte des obligations (Lericollais 1999 : 668) coutumières à l’égard du maître de feu, son droit de culture est imprescriptible et héréditaire.
Outre la redevance annuelle et généralement symbolique (une gerbe de mil par exemple) versée pour chaque champ occupé, les obligations du borom ngadio envers le borom daay prennent une importance et une solennité particulière au moment de la mort du lamane et l’entrée en fonction de son successeur. Il en va de même lorsqu’un paysan devenant chef de famille hérite, avec le patrimoine paternel, le droit de hache. Dans les deux cas, l’hommage à un nouveau lamane ou la reconnaissance du droit émanant du maître de feu par un paysan nouvellement investi du droit de hache entraîne un don important tel qu’un grenier de mil ou une tête de bétail. Cependant, il est à noter que de telles redevances ne représentent pas dans leur essence une rente foncière, même si elles ont pris ultérieurement le caractère ; elles traduisent naguère une hiérarchie, des liens de dépendance d’homme à homme liés à une situation sociopolitique. Droit généralement accordé aux catégories sociales exclues du contrôle de la terre, il permet de faire ressortir le caractère communautaire des biens dans la société Sérère qui doivent permettre à ses différentes composantes de pouvoir survivre.
A côté des droits fonciers principaux, on note aussi l’existence d’autres voies juridiques susceptibles de permettre aux autres habitants de cette localité de pouvoir jouir pleinement des fruits provenant de l’usage de la terre. Ces droits fonciers dérivés les plus usités sont principalement le prêt d’une part et d’autre part la location. Dans la communauté rurale de Fissel, l’appartenance directe ou indirecte à la société confère un droit d’usage automatique. Mais le droit d’usage peut être attribué sous forme de prêt (Crousse / Le Bris / Le Roy 1986 : 426), gratuit ou onéreux. Le prêt est un « contrat par lequel une des parties, le prêteur, remet à un autre, l’emprunteur, une chose dont ce dernier pourra user, à charge de la restituer, en nature ou par équivalent » . Le droit d’usage direct est celui exercé par les descendants, membres authentiques de la communauté. Quant à l’usage indirect, il correspond généralement au prêt qui peut revêtir deux formes.
S’agissant du prêt conditionné ou onéreux, il convient de le distinguer de la location. En effet, si le premier met en lumière un mode de répartition des terres et aussi les rapports sociaux, le second qui est la recherche du profit et de l’investissement sur la terre ne crée pas lui aussi des rapports capitalistes, ayant la terre comme support. Le prêt onéreux, contrairement au prêt gratuit, est un contrat synallagmatique, assortit de certaines conditions et redevances. Les contreparties ne sont jamais en espèces mais en nature ou en prestation de travail. On peut définir la redevance foncière comme un droit matériel ou non, perçu sur la terre en raison du statut de l’exploitant, ou en raison d’un contrat entre le maître foncier et l’exploitant. Caverivière et Debène ont affirmé que la redevance était symboliquement versée sous forme de gerbes de mil. Mais cette redevance est actuellement financière dont l’emprunteur est tenu de verser au propriétaire du lopin de terre en guise de reconnaissance de l’existence de relation contractuelle entre eux. En cas de cessation du prêt soit sur initiative du maître foncier soit sur celle de l’emprunteur, obligation est faite au premier de reverser la redevance de quelque nature qu’elle soit au détenteur temporaire du droit d’usage. Le prêt sans condition ou prêt gratuit ne prévoit aucune redevance dans la mesure où il se fonde sur la solidarité et l’assistance mutuelle. Il est perçu comme étant un droit d’exploitation d’un lopin de terre accordé par un maître foncier à un individu. Il se fait au profit d’amis, de parents, d’anciens captifs surtout et d’étrangers.
De nos jours, les prêts de terres sont devenus tournants. L’emprunteur ne fait jamais plus qu’une saison sur une même terre. Ce phénomène s’explique par le fait que celui-ci ne pourra en aucun cas se prévaloir du temps qu’il a exploité la terre pour devenir au nom de la loi sur le domaine national le propriétaire du droit d’usage au détriment du véritable détenteur du droit foncier principal. De manière plus claire, on constate que les prêts de terres sur une longue période, de même que la possibilité de faire certains actes sont réglementés de sorte que l’emprunteur, en cas de conflits, ne puisse se prévaloir d’une mise en valeur au bout de deux années pour se faire affecter les sols. En dehors du prêt, certaines couches dépourvues de terres peuvent aussi recourir à la location pour jouir pleinement des ressources foncières.
Les modes d’occupation traditionnels de la terre, conjugués à la situation du monde rural marqué par une dégradation sans précédent des ressources naturelles intimement liée à une densification de la population rurale posent un certain nombre de problèmes relatifs à l’accès aux biens fonciers. Un tel phénomène a conduit l’adoption d’un certain nombre de méthodes par lesquelles les exploitants ont la possibilité d’accéder à la terre une fois qu’ils acceptent de se conformer à la tradition. La location de la terre, bien étant une pratique formellement interdite par la loi, demeure être monnaie courante dans cette localité et permet à certaines catégories d’individus de pouvoir survivre grâce aux ressources tirées de la terre. Cette pratique découle du principe de base qui régit le droit foncier traditionnel et qui repose sur l’idée selon laquelle « la terre n’est pas un bien accumulable mais un moyen de survie et de production du groupe social et de ses éléments constitutifs » (Crousse / Le Bris / Le Roy 1986 : 426). A cette fin, le droit d’usage de la terre doit être assuré à tous les membres de la communauté dans le présent comme dans la future avec l’obligation pour les allochtones surtout de verser une contrepartie ; la nature et les formes de celle-ci sont variables selon les cas.
La pratique qui consiste pour un exploitant de payer une redevance en espèce ou nature en contrepartie de la mise en valeur d’un lopin de terre appartenant à un maître foncier, est temporaire (Deville / Toulmin / Traoré 2000) et s’éteint en général après la phase des récoltes. De ce fait, la location ne confère plus à son titulaire un droit d’usage à long terme. Les transformations des relations entre les locataires de terres et les maîtres fonciers procèdent de la prudence de ces derniers. En effet, la location de terres sur une durée relativement longue a permis à pas mal d’exploitants au moment de l’entrée en vigueur de la loi sur le domaine national de se reconvertir en de véritables maîtres fonciers des terres, objet de location. Cette loi a conféré à ces exploitants des droits d’usage ne pouvant plus être révoqués et se transmettant de génération en génération au détriment du lamane et a animé de vives querelles au sein de cette localité et ces litiges perdurent dans le temps. En somme, on aperçoit visiblement à travers le régime foncier traditionnel, une véritable organisation concernant les modes d’accès à la terre. Une telle organisation est néanmoins assortie d’un certain nombre de règles qui déterminent son fonctionnement.
Les règles qui régissent le fonctionnement du foncier traditionnel sont relatives d’une part aux modes d’acquisition des droits sur la terre (souvent par héritage), selon un régime patrilinéaire. Chez les Sérères, la transmission (Lericollais 1999 : 668) de père en fils des droits de hache est fréquente en principe. Elle a lieu si le premier défricheur ait opéré indépendamment des membres de sa famille maternelle avec la seule aide de ses fils ou lorsqu’il s’agit d’un défrichement récent, donc l’acquisition d’un bien personnel normalement transmis de père en fils.
Dans le système traditionnel, la terre est d’abord un bien lignagère (Lericollais 1999 : 668). Elle appartient à une communauté parentale à la tête de laquelle se trouve un responsable qui est à ce titre le gérant en matière foncière parce qu’étant le digne hérité du titulaire du droit foncier originaire. A cet effet en cas de décès du responsable, le caractère indivis demeure et la succession revient toujours à l’aîné (Lericollais 1999 : 668). C’est pourquoi, les titulaires du droit de hache ou leurs héritiers pour continuer à exercer leurs droits sur les terres concédées doivent en cas de décès du lamane s’acquitter des obligations coutumières.
L’accomplissement de ce rituel permet de maintenir les relations entre le maître foncier et le titulaire de droit de hache au beau fixe et aussi longtemps que le maître de hache borom-ngadio honore ce lien, son droit de culture est imprescriptible et héréditaire. Dans cette même ordre d’idées Paul Pélissier (1996 : 32) nous apprend que :
L’ancienneté des droits fonciers dans le Cayor, le Baol, et une partie du Djolof, est attestée par la survivance de l’appropriation de nombreuses terres à des « Lamanes » dont les droits remontent à l’époque du peuplement Sérère et une plus grande partie du terroir Sérère appartient à des « Lamanes ».
Toutefois, même si ce système de transmission des droits sur la terre est dominant, force est de constater que les droits fonciers peuvent s’acquérir de manière matrilinéaire. Dans la société traditionnelle, la transmission des droits se fait en général de manière patrilinéaire (Niang 1984), c’est-à-dire de père en fils. Cependant, il convient de préciser que même si la dévolution patrilinéaire des terres lignagères a été d’emblée un mode quantitativement dominant, du moins dans cette localité, il n’en demeure pas moins que le système matrilinéaire (Niang 1984) continue de s’ériger en une exception et permet de ce fait aux ayants droits d’acquérir des prérogatives foncières.
B. Une timide application de la LDN par les collectivités locales
L’application de la loi sur le domaine national fait ressortir le véritable pluralisme juridique dans lequel baigne le droit sénégalais surtout en matière foncière. En effet, la réalité permet de constater que même si c’est la loi qui devait primer sur les modes d’accès traditionnels, la forte présence des règles locales dans les modes de gestion annihile les efforts de l’État dans sa politique de moderniser le droit foncier. Bien qu’étant simple au regard de la loi, l’application de la procédure d’affectation des terres par le conseil rural demeure loin d’être une chose aisée, et ce phénomène produit un certain nombre d’effets qu’il faudra préciser.
La procédure d’affectation des terres du domaine national comporte deux éléments : d’abord l’introduction d’une demande d’affectation de terres par l’intéressé auprès du conseil rural puis une délibération par celui-ci suivie d’une approbation du Représentant de l’État. A ce titre la loi a clairement prévu que tout citoyen désirant occuper une parcelle du domaine national doit formuler une demande d’affectation adressée à l’organe de décision de la collectivité locale et attendre la notification de l’acte affectataire. Le demandeur doit alors justifier sa « capacité de mettre en valeur » la superficie demandée. Autrefois, cette demande était adressée au Président du conseil rural mais de nos jours elle est adressée au conseil rural. L’affectation d’une terre du domaine national est prononcée par délibération après examen de la demande reçue, afin d’apprécier les capacités d’exploitation du demandeur ainsi que de la disponibilité de la terre. A cet effet, la collectivité peut donner mission à sa commission domaniale de procéder à l’enquête sur le terrain et de formuler ainsi un avis pour éclairer la décision de l’organe délibérant. Ces dispositions s’appliquent aussi bien aux hommes qu’aux femmes. En outre, en vertu du contrôle de légalité, les actes relatifs au foncier sont transmis au Représentant de l’État pour approbation sans laquelle ils ne seront pas exécutoires.
Au regard des règles qui gouvernent cette procédure, elles se caractérisent surtout par leur simplicité. Ainsi les autorités locales ne devraient en cas se confronter à des problèmes pour leur application. Cependant, en réalité ces autorités rencontrent des difficultés pour appliquer à la lettre ces dispositions. Ces difficultés sont inhérentes aux pratiques locales encore fortement dominées par la tradition. En effet, la gestion traditionnelle est privilégiée par les populations avec une complicité partagée par les demandeurs et les détenteurs de terres. Malgré l’avènement de la loi sur le domaine national qui confie la gestion des terres au conseil rural, la gestion coutumière est toujours en vigueur dans les villages. Au niveau de chaque carré, la gestion des terres est sous l’autorité du chef de famille pour la distribution infra familiale. Avant l’entrée en vigueur de la loi sur le domaine national, il revenait au « Lamane » en tant qu’administrateur des biens fonciers de la communauté la tâche de la répartition des terres en vertu du principe communautaire, socle de la solidarité rurale. Il était donc chargé d’affecter et de les repartir les terres entre collectivités familiales chargées de les exploiter. En effet, le modèle traditionnel des terres était caractérisé par cinq (Chabbas 1965) éléments fondamentaux :
• la terre est un bien collectif à la disposition de toute la communauté ;
• la terre est gérée par un administrateur dans l’intérêt de la communauté ;
• le droit de mettre en valeur la terre est assuré à toute personne de la communauté ;
• la terre est un bien inaliénable ;
• la terre est sous le contrôle des puissances sacrées et Dieu.
Au demeurant, une précision des effets de l’application du décret relatif à l’affectation et à la désaffectation permettrait une meilleure compréhension des nouveaux rapports entre les anciens maîtres fonciers et les actuels gouvernants locaux. En réalité, les changements induits par le décret d’application de la loi sur le domaine national ont été mal perçus à travers le monde rural. Il en est ainsi dans la mesure où l’introduction de cette loi dans les campagnes a eu comme conséquence un bouleversement de l’organisation sociale (Faye 2008 : 20) traditionnelle par la mise en place de nouvelles élites ayant compétence pour administrer les biens fonciers. Ces innovations mal accueillies par les ruraux, continuent d’animer les rivalités entre forces traditionnelles et autorités locales et justifient par voie de conséquence les raisons principales de l’échec de la réforme foncière. Ces conflits de pouvoirs entre les chefs coutumiers, responsables de la gestion des terres et les autorités légalement investies par l’État sont au cœur des manquements relatifs à l’application de cette réforme foncière.
Il existe aussi d’autres facteurs toujours endogènes qui empêchent à ces autorités de pouvoir respecter la procédure d’affectation. Ceux-ci tiennent au fait que la plupart des élus sont généralement issus des familles lamanales ou proches d’elles et bénéficient également de leur suffrage. De ce fait, ces liens peuvent constituer véritablement un frein pour ces élus lorsqu’ils seront appelés à prendre des décisions susceptibles de causer des désagréments aux organes traditionnels. En d’autres termes, le conseil rural est donc impérativement tenu de prendre en compte les intérêts de ces groupes de pression que représentent les chefs de terres dans l’exercice de leurs prérogatives foncières. De plus, dans une société fortement ancrée à la tradition la réaffectation de terres antérieurement exploitées par une personne à une autre peut constituer un début de conflits. Par ailleurs, les organes locaux se trouvent également devant une situation d’impasse juridique liée au fait que les textes n’ont pas définis avec clarté les critères relatifs à l’affectation des terres du domaine national. Les critères relatifs à l’affectation des terres du domaine national n’ont pas fait l’objet d’une définition claire par le législateur. Cette imprécision affecte aussi bien le critère de résidence que celui de la mise en valeur.
Le conseil rural commence véritablement à user de ses prérogatives en matière de désaffectation des terres du domaine national. Néanmoins, de telles prérogatives sont difficiles à mettre en œuvre malgré la simplicité de la procédure à adopter à cet effet. La complexité de la désaffectation des terres du domaine national tient au fait que l’insuffisance de mise en valeur de la terre comme motif de désaffectation n’est pas encore une réalité. L’affectation d’une parcelle du domaine national suppose que l’affectataire soit en mesure de la mettre en valeur. A cet effet, le décret nº 72-1288 à travers son article 3 alinéa 2 précise que : « l’affectation est prononcée en fonction de la capacité des bénéficiaires d’assurer, directement ou avec l’aide de leur famille la mise en valeur de ces terres conformément au programme établi par le conseil rural ». A la lecture de cet article, il ressort l’idée selon laquelle, si la capacité de mise en valeur est une condition d’affectation des terres du domaine national, la logique voudrait que la non mise en valeur ou l’insuffisance d’une mise en valeur soit une condition de désaffectation de ces terres. C’est du moins ce que l’article 9 du décret de 72-1288 semble énoncer quand il prévoit qu’une « […] insuffisance de la mise en valeur […] » peut être une cause de désaffectation totale ou partielle.
Généralement, l’insuffisance de mise en valeur est retenue lorsqu’au bout d’un délai bien déterminé (généralement de 2 ans) et notifié à l’affectataire, celui-ci n’arrive pas à exploiter la parcelle qu’on la octroyé. Les autorités locales dans l’exercice de cette compétence ont souvent des problèmes pour apprécier ce qu’est effectivement l’insuffisance de la mise en valeur. En plus, la loi semble imposer au conseil rural une obligation de motivation de la décision de désaffectation qui serait prise sur la base d’un défaut de mise valeur, en décidant qu’ « à défaut d’un tel arrêté (préfectoral) le conseil rural ne saurait se contenter dans sa décision du simple motif d’insuffisance de mise en valeur sans préciser en quoi cette carence serait reprochée à l’affectataire ». C’est le sens de la décision de la Cour Suprême du 25 mars 1981 affaire El Hadji Massamba Fall contre État du Sénégal. Cela justifie le laxisme des autorités locales du moment où elles seront toujours appelées à fournir les éléments sur la base desquels ils se sont fondés pour désaffecter une terre relevant du domaine national au motif du défaut de mise en valeur ou son insuffisance.
Dans la pratique, les conseils ruraux abordent les délais de mise en valeur d’une manière uniforme de deux années sans compter de l’envergure des projets ni la capacité personnelle et financière des affectataires. Mais ce délai de deux ans qui n’est pas prévu par aucun texte pose un autre problème et a des effets directs sur la qualification de la mise en valeur par les Conseils ruraux : à partir de quand commence t-il à courir ? Au jour de la délibération, au jour de la délimitation ou au jour de la délibération par le sous-préfet ? Les investigations menées dans cette localité mettent en exergue que le conseil rural n’a jamais désaffecté une terre du domaine national pour motif d’une insuffisance de mise en valeur par l’affectataire. L’explication de cet amateurisme peut être liée au fait que les superficies les plus importantes sont affectées aux hommes d’affaires ou aux marabouts qui ont présentés des projets insusceptibles d’être finalisés dans un délai de deux ans et qui participeraient dès leur réalisation au développement de la localité. Par ailleurs, les terres affectées pour des motifs agricoles, pastorales ou à l’habitat souffrent rarement d’une insuffisance de mise en valeur dans la mesure où elles visent à satisfaire souvent des besoins immédiats et par conséquent sont utilisées par les bénéficiaires dès l’acte de notification. En outre, même si on remarque que l’insuffisance de la mise en valeur est rarement mise en branle par le conseil rural pour procéder à une désaffectation des terres du domaine national, il est tout de même fréquent de voir ce conseil rural désaffecter certaines terres pour d’autres raisons prévues par la loi (intérêt général).
II. Des modes concurrentiels de gestion des conflits
Si nous prenons le niveau de la communauté rurale, on pourrait analyser le phénomène des conflits fonciers sous différents angles liés aux enjeux et aux acteurs, pour aboutir au même résultat : la compétition sur les ressources et des situations conflictuelles permanentes. D’où toute l’importance d’un essai de typologie (A.) avant d’exposer les modes de règlement de ces conflits (B.).
A- Typologie des conflits fonciers
La survenance des conflits liés au foncier découle de l’enjeu que cette ressource suscite au niveau des populations particulièrement rurales. Le premier enjeu est celui lié au pouvoir local. En effet, il faut admettre aujourd’hui que le régime républicain a remis en cause le système de pouvoir local traditionnel. L’égalité devant la loi, l’égal accès aux fonctions et aux responsabilités reconnus par les textes fondamentaux vont entrainer un phénomène de contestation, même si l’on peut considérer qu’elle n’est pas toujours ouverte. Les anciens exclus du pouvoir traditionnel : anciens captifs, jeunes, femmes et même étrangers au terroir vont non seulement résister à la loi et aux sollicitations des autres acteurs, mais ils vont finir par adapter et domestiquer cette logique républicaine à leur profit : l’enjeu du pouvoir va se situer dans le contrôle des collectivités locales, par le biais d’un contrôle préalable des appareils des partis en compétition. Ainsi, les collectivités locales seront accaparées par des responsables politiques locaux qui se réclament des anciennes familles et catégories dirigeantes. Cet accaparement du pouvoir par des moyens légaux et démocratiques, par domestication de la loi, va constituer une cause de conflits parfois violents : il s’agit de scissions ou tentatives de scissions entre catégories sociales au sein des entités villageoises. Ces menaces vont ainsi devenir une arme et un moyen efficace et alternatif de gestion des conflits de ce type, parce que souvent par le dialogue des concessions peuvent être faites de part et d’autre.
L’autre enjeu est relatif au contrôle de la gestion des ressources naturelles. Il s’agit là de la manifestation la plus importante des conflits, parce que non seulement les droits peuvent être en cause, en plus ce sont les systèmes de production qui vont constituer le cœur de l’enjeu. L’enjeu politique du pouvoir local va trouver, au niveau des ressources naturelles, un terrain fertile à son développement et à celui des conflits. Parce que les acteurs à ces conflits peuvent être nombreux, divers, selon les ressources en cause. La violence des conflits dépend à la fois de l’importance de la ressource et du poids de l’acteur. Il y a aussi que les modes et instances de règlement de ces conflits nés de la compétition sur l’espace et les ressources de la collectivité locale dépendent de facteurs que ces collectivités ne maîtrisent pas toujours. Quant à la ressource foncière, elle est devenue, avec la loi 64-46 du 17 juin 1964, une ressource qui polarise toutes les convoitises, en éveillant l’instinct territorial des individus et du groupe. La terre est un bien appartenant à la Nation. Donc, égalité d’accès à la ressource et dans certaines conditions, égalité dans le pouvoir de contrôle. Mais ce pouvoir de contrôle et de gestion, s’il ne pose pas de problème dans sa logique et dans son articulation, est source de graves déséquilibres au niveau de son application par les collectivités locales, particulièrement les communautés rurales.
Les conditions d’affectation et de désaffectation, entre autre, de résidence et de mise en valeur participent de l’esprit d’égalité mais, sans définition, ni contenu précis donnés par les textes, les manipulations en deviennent aisées (Traoré 1996). De ce fait, chaque communauté rurale mettra en œuvre sa propre stratégie, qui parfois, est d’exclusion des autres acteurs. Les maitres fonciers traditionnels étant devenus les dirigeants des conseils ruraux, détiennent par ce biais tout le pouvoir foncier qui leur permet de combiner l’esprit de la loi et les mécanismes coutumiers de contrôle des terres. Les conséquences vont se manifester à différents niveaux, sources de conflits autour de cette ressource socle ; c’est que la pression sur la terre est telle que la compétition devient forte, voire plus violente, notamment quand des critères comme le statut de propriétaire foncier coutumier d’une terre est exigé des demandeurs d’affectation des terres du domaine national, dans certaines collectivités locales. Ce déséquilibre sociologique qui viole la loi, et qui a la bénédiction tacite des autorités de tutelle, au nom de la paix départementale, est source de conflits dont les conséquences sont parfois dramatiques. Mais les déviations de la logique foncière officielle se situent aussi à un niveau où la confrontation est la plus vive, où l’espace devient un enjeu de survie tant sur le plan des droits qu’à celui de la distribution de ces droits, c'est-à-dire l’utilisation des ressources.
C’est au niveau de la gestion de l’espace pastoral que cette confrontation est plus vive. Le fondement de ce biais se trouve dans l’absence de politique de mise en valeur pastorale, le refus de reconnaître, dans les politiques comme dans les pratiques, le pastoralisme comme forme de mise en valeur des terres du domaine national. L’affectation des terres du domaine national, dans la pratique des communautés rurales, ne se peut se concevoir que pour l’agriculture. L’élevage va ainsi devenir, en matière foncière et de gestion de l’espace et des ressources, une catégorie résiduelle. Même si théoriquement les terres du domaine national sont destinées à l’agriculture, l’élevage et l’habitat et que dès 1964, on a reconnu aux communautés rurales cette capacité d’affectation de l’espace en équilibre, dans la pratique, les conseils ruraux n’affectent des terres que pour l’agriculture. Et le texte qui est censé organiser l’élevage sur le domaine national lui-même, à savoir le décret 80-268 de mars 1980, a subi le même biais, parce que son objectif en réalité n’était pas de gérer cette activité, mais plutôt de sécuriser l’agriculteur en limitant dans un espace les parcours de bétail. Cet espace des parcours va servir à limiter les divagations dans les champs. Autrement dit, l’espace défini par ce décret était seulement celui de qui n’était pas utilisé pour l’agriculture. Le confinement de l’élevage dans cet espace réduit, l’avancée du front agricole favorisée par les politiques étatiques et communautaires constituent les sources des conflits les plus graves et les plus fréquents : conflits entre agriculteurs et éleveurs. Les exemples sur les enjeux et en même temps les causes des conflits peuvent être multipliés à l’infini car étant liés aux dysfonctionnements des structures décentralisées, mais aussi sur les textes relatifs au foncier, qui limitent les possibilités de mise en œuvre des mécanismes fiables de règlement des conflits.
Dans notre collectivité locale de recherche, nous avons noté qu’il existe d’une part des conflits au sein d’une même catégorie socioprofessionnelle et d’autre part des conflits opposant plusieurs catégories socioprofessionnelles. La prédominance des voies traditionnelles d’accès à la terre est souvent à l’origine des conflits fonciers. Ceux-ci peuvent être liés soit aux problèmes des conflits de droits coutumiers ou à la contestation des limites entre deux champs. Les sources susceptibles d’animer les conflits au sein des acteurs d’une même activité sont multiples. Il peut s’agir d’une revendication d’un droit à la terre par le maître de la terre au titulaire du droit de hache suite au non respect par ce dernier des obligations coutumières prenant la forme de redevances symboliques. Cette situation peut conduire à la remise en cause du droit de la hache qui est en principe un droit imprescriptible et héréditaire tant qu’il y avait respect par l’ancien borom ngadio ou son successeur de la hiérarchie, des liens de dépendance à l’égard du Lamane. C’est ainsi que le Conseil Rural a été saisi d’une affaire opposant un détenteur coutumier de droits fonciers à un usager légal. Le premier a invoqué le droit coutumier, la séniorité pour tenter de reprendre le champ, or l’usager a fait valoir la durée de son usager sur la parcelle. Le Conseil Rural a finalement donné le champ, objet du litige à l’usager parce que la loi ne reconnaît le droit de propriété mais le droit d’usage. Cependant, la majeure partie des conflits prend leur racine dans l’héritage de la terre communément appelé par la loi la problématique de la réaffectation des terres du défunt.
Par ailleurs, au niveau de cette localité, la délimitation des champs demeure encore une question brûlante et est à l’origine de multiples conflits. Les raisons de ce phénomène se justifient d’une part par la parcellisation excessive des lopins de terres et d’autre par une délimitation parfois superflue des champs. Néanmoins, il existe des pratiques locales de protection et de gestion des ressources naturelles. De telles pratiques s’inscrivent dans le souci de mieux conserver les sols et les ressources. Parmi celles-ci, on peut noter : la régénération naturelle assistée (le Salane), les clôtures (haies vives) etc. Toutefois, il faut préciser que de telles règles sont dépourvues d’une force juridique ; de ce fait, les plaignants ne peuvent en aucun cas s’en prévaloir devant l’autorité locale pour donner une suite favorable à leur demande. Mais, ces règles locales peuvent guider la décision du conseil rural en ce sens qu’elles lui permettent avec l’aide des témoins des parties au litige d’avoir une idée des limites des champs, objet du litige. A côté de ces catégories de conflits, on note que d’autres peuvent opposer des catégories socioprofessionnelles différentes.
Dans les zones de terroirs, on observe une compétition pour l’espace entre agriculteurs et éleveurs. Cette situation est souvent à l’origine des conflits entre les acteurs qui se livrent à ces activités. Ces conflits indirectement liés à une conquête foncière, peuvent émaner d’une part des situations où les champs sont détruits par les troupeaux ou des problèmes de parcours du bétail d’autre part.
B- Modes de règlements des conflits
Devant une situation conflictuelle découlant de la gestion du foncier dans le cadre du pluralisme juridique, des mécanismes de règlement sont activés afin d’apaiser la paix sociale. Il s’agit d’une part des modes traditionnels de résolution de ces litiges, qui sont les plus usités et des pratiques modernes de règlement de ces litiges d’autre part. L’accès à la terre a toujours donné lieu à des litiges dont la résolution fait appel à la mise en place d’un certain nombre de mécanismes. Ceux-ci peuvent revêtir la forme traditionnelle ou puiser leurs sources dans la religion. L’importance de la terre a suscité chez les sociétés traditionnelles la mise sur pied des méthodes visant à mettre fin aux conflits latents ou d’hostilités ouvertes. Ces méthodes consistent en une mise en place d’une commission des sages d’une part ou d’une institution comprenant les responsables locaux. Conformément aux normes coutumières en vigueur dans le monde rural, la gestion de la question foncière est confiée à des organes chargés de trouver une issue heureuse aux conflits fonciers. C’est la raison pour laquelle, « une commission des sages » (Deville / Toulmin / Traoré 1986 : 262) est instituée à chaque fois qu’un conflit éclate entre les catégories socioprofessionnelles. D’une nature ad hoc, elle est chargée de mettre fin aux conflits par voie de conciliation des parties ou de d’arbitrage. De ce fait, elle constitue la première instance de résolution des conflits de quelle que nature qu’elle soit.
L’efficacité de cette commission réside dans le fait que ses membres sont choisis par les parties en litige et ceux-ci ayant une maîtrise parfaite des règles de gestion de l’espace prennent généralement des décisions acceptées par les protagonistes. Généralement désignés parmi les chefs coutumiers, les membres de cette commission en tant qu’autorités morales, sont investis de pouvoirs de conciliation des parties en litige en ce qui concerne les problèmes de la terre. La fréquence et l’intérêt que revêt ce règlement traditionnel des litiges fonciers sont affirmés par le Professeur Samba Traoré en ces termes :
Les groupes de médiation foncière sont constitués par les acteurs traditionnels de la conciliation c'est-à-dire certaines catégories sociales tels que les anciens captifs […] et surtout les marabouts. Leur intervention met dés lors le conflit aux palabres avant qu’il n’arrive éventuellement à l’autorité administrative.
Les explications de l’intensité des modes d’usage de ces recours sont d’origines socioculturelles. En effet, dans cette localité, la solidarité est encore vivace car les habitants, en majorité Sérères, sont fortement unis par des liens de parenté qui marquent leur emprunte sur le fonctionnement de la collectivité.
Ainsi avec l’indépendance des chefs d’unité économique vis-à-vis du groupe pris comme collectivité, les conflits des chefs de carré ou des membres de carré différents ou non sont réglés par le groupe de trois ou les personnes dont la composition est fortement influencée par l’âge. Ce groupe comprend toujours des personnes connaissant l’histoire des différentes implantations familiales. Cette commission est constituée en cas de conflits opposant agriculteurs et éleveurs conformément à leur accord de deux médiateurs agriculteurs et de deux médiateurs éleveurs dont leur rôle consiste en l’estimation des dégâts sur la culture, afin de proposer une indemnisation que les parties, très souvent, acceptent. Plus connue sous le nom de « janbur » (Deville / Toulmin / Traoré 1986 : 263) dans la zone sylvo-pastorale, cette commission composée des chefs traditionnels en générale, est chargée d’estimer et de proposer une réparation pour les dégâts sur les cultures. Elle intervient aussi à la demande des parties dans les autres types de conflits relatifs à la gestion de l’espace. Ses décisions sont sécrètes, officieuses et orales. Cependant, elles sont susceptibles d’être attaquées devant le chef de village qui constitue l’arbitre suprême en matière de règlement par voie traditionnelle au niveau de l’espace villageois.
Ensuite, nous avons le chef de village. Le village africain est l’unité politico administrative où s’exercent les décisions du pouvoir central ; mais il est aussi un centre de distribution et de circulation des biens de la terre. Composé par un certain nombre de carrés, il est placé sous l’autorité d’un chef de village. Ce dernier est chargé d’apporter des solutions aux différentes questions y comprises les litiges dans le domaine de la terre. Son intervention se situe généralement après l’échec de la médiation de la commission des sages. Il peut être saisi par la partie contestataire de la décision de la commission des sages ou d’office par l’une des parties en conflit. Il choisit contrairement à la commission des sages, les personnes qu’il juge compétentes pour mettre un terme au cas d’espèce. A côté du chef de village, les organes religieux interviennent pour juguler certains conflits fonciers : il s’agit essentiellement de l’Imam ou des représentants des confréries religieuses.
A côté des voies classiques de résolution des conflits relatifs à la terre, d’autres instances de résolution des problèmes liés à la terre sont également mis en place par l’État. Il s’agit d’une part des organes locaux et d’autre part l’intervention de l’autorité administrative déconcentrée. La réglementation des problèmes de la terre fait intervenir après l’épuisement de la procédure de médiation et de conciliation les organes locaux qui sont officiellement investis de l’administration de la collectivité décentralisée. Cette intervention est d’abord du ressort du président du conseil rural et peut être aussi le fait de la commission domaniale. Organe collégial, le Conseil Rural représente les membres de la communauté rurale. Ces attributions foncières placent le Conseil Rural au cœur de la résolution des conflits qui découlent de la tenure des terres. L’examen des conflits recensés au niveau de la communauté rurale de Fissel permet de constater que les conflits se posent, pour l’essentiel, en termes de légitimation d’un droit. Il faut également préciser que, quelque soient les sources du conflit, la période de résolution est révélatrice. En effet, c’est généralement au moment de l’approche de l’hivernage que les litiges arrivent devant l’instance locale. Très souvent, à la lecture des arguments des parties, on apprend que les protagonistes ont préalablement recouru aux services d’une tierce personne avant la saisine du Conseil Rural par le biais de son président. Dans la tradition, la dénonciation d’un don de terre est une chose comprise et acceptée par tous. Il en est de même de la reprise d’un champ donné à gage qui peut survivre dès lors que la dette a été totalement honorée. Mais dans la loi gage et don sont inconnus et l’usage prime si l’on est en mesure de prouver sa qualité d’usage sur une longue durée. Dans les cas qui lui sont soumis, le conseil rural prend en général trois types de solution pour mettre définitivement un terme au conflit.
En outre, le Conseil Rural peut aussi déléguer cette tâche à la commission domaniale. Les enjeux de la terre dans les terroirs ont conduit à la mise en place des structures directement rattachées au Conseil Rural qui sont chargés d’aider celui-ci dans les tâches relatives à la gestion des questions foncières. Cette commission domaniale exerce ces compétences pour le compte du Président Conseil Rural. En effet, celui-ci est la première instance responsable de la gestion des terres du Domaine National. Il en est ainsi dans la mesure où aux termes des dispositions de l’article 209 de la loi 96-06 du 22 mars 1996 du CCL, le Président du Conseil Rural est l’organe exécutif de la Communauté Rurale. Toutefois, l’article 299 de cette même loi autorise le Conseil Rural à former des commissions pour l’étude des questions entrant dans ses attributions et le Président du Conseil Rural, dans ses fonctions exécutives, délègue en général en permanence ce pouvoir de règlement des litiges à la commission domaniale qui constitue l’organe le plus important du Conseil, parce que elle instruit tous les dossiers fonciers de la demande d’affectation et au suivi de la mise en valeur. Considérée comme une sorte d’observatoire, cette commission connaît toutes les questions qui peuvent se poser en matière domaniale. De ce fait, elle instruit les demandes et plaintes et donne la solution. Concernant certains litiges liés à la terre, la commission se rend souvent sur les lieux pour entendre les parties et les témoins. Après cette phase, un consensus est généralement trouvé avec les parties sous réserve d’une délibération du Conseil Rural à cet effet. Mais en pratique, à part les litiges entre héritiers d’un affectataire, les contestations mineures pour double affectation, ou les litiges concernant les délimitations, les confits fonciers les plus importants ne sont traités par le Conseil, parce qu’elle ne dispose pas d’un pouvoir de coercition.
Cependant, quels que soient l’efficacité de ces organes locaux dans la résolution des problèmes relatifs à l’usage de la terre, il est aussi évident que les autorités déconcentrées sont sollicitées de plus en plus par les populations pour trouver une solution à leur litige. Le Représentant de l’État par ses attributions, intervient dans tous les domaines où la collectivité locale a reçu compétence conformément à la loi. Ainsi, en matière foncière par le biais de son pouvoir d’approbation, il règle en amont les problèmes liés à la terre ; de même, il peut être saisi en tant qu’autorité pour mettre fin à un litige foncier. Le contrôle de légalité est un moyen de prévention des problèmes fonciers. La gestion foncière locale est le fait de deux principaux intervenants : le Conseil Rural et l’administration. Cette dernière est représentée par le sous-préfet et les agents de services administratifs chargés de mener la politique de développement retenue par les pouvoirs publics. L’importance de l’autorité déconcentrée réside dans le fait qu’elle est dotée de pouvoirs lui permettant de contrôler les actes pris par les organes locaux conformément aux règlements en vigueur.
A côté du conseil rural, l’administration territoriale locale (préfet et sous-préfet) a acquis depuis longtemps une importance de premier plan. Bien que juridiquement, à part les recours administratifs, ces instances ne soient pas habilitées à gérer les conflits fonciers, les plaintes les plus nombreuses et les plus fréquentes sont acheminées vers ces autorités. Et parfois au mépris des règles et principes qui les régissent, elles se substituent à l’instance régulière pour régler des cas, par contournement des textes et des procédures. Cependant, ces « instances ne doivent en aucune façon s’immiscer dans la gestion foncière » . Cependant, la tutelle administrative autorise ces organes à prendre des décisions parfois en marge de la réglementation en vigueur. Il en est ainsi dans la mesure où la peur du « commandant » est telle, depuis la période coloniale, qu’on hésite à l’attaquer en justice. C’est pourquoi, les parties en cause contestent la décision arrêtée par le conseil rural lors du règlement d’un litige, elles ont la possibilité de recourir pour arbitrage au sous-préfet dans le mois qui suit la notification. A cet effet, l’article 19 du décret 72-1128 : « toute personne qui se prétend lésée par une affectation ou une désaffectation peut recourir au sous-préfet, dans le mois qui suit la notification ». En outre, ce même article dans al 2 dispose que :
Le sous-préfet peut décider d’annuler la décision ou d’en suspendre l’exécution, soit sur la réclamation de la partie intéressé, soit d’office par inopportunité, mauvaise appréciation des circonstances ou violations des lois règlements en vigueur.
Le recours à la justice (tribunaux) est rarement une solution dans la mesure où, très souvent, ces mécanismes locaux et traditionnels de gestion des conflits arrivent à régler les différends, faisant ainsi du recours juridictionnels une exception.
Conclusion
La loi sur le domaine national et le code des collectivités locales ont donné des compétences de gestion des terres aux communautés de base. Cependant, au regard de la forte prégnance du droit coutumier, cette application des deux textes juridiques est fortement limitée, rendant impossible toute tentative de ‘domestication’ du rural. Si le droit positif contenu dans ces textes juridiques a été considéré comme des innovations dans la perspective de moderniser le monde rural, il faut avouer que ces derniers ont échoué. D’ailleurs, des réformes du droit de la décentralisation et du droit de la terre sont en cours. Mais, il faut avouer que toute initiative tendant à contourner les logiques et pratiques foncières locales serait inopérante ; à la limite, ces textes juridiques resteront ineffectifs, et seront à la limite des sources de conflits. D’où l’impératif de prendre en compte dans la perspective de toute réforme les aspects pertinents du droit coutumier.
Bibliographie
Chabbas, Jean 1965 : « Le domaine national du Sénégal : réformes foncière et agraire », in : Annales Africaines, pp. 37-70.
Crousse, Bernard / Le Bris, Émile / Le Roy, Étienne (éds.) 1986 : Espaces disputés en Afrique Noire : Pratiques foncières locales, Paris : Karthala.
Deville, Philippe Lavigne / Toulmin, Camilla / Traoré, Samba (éds.) 2000 : Gérer le foncier en Afrique de l’Ouest. Dynamiques foncières et interventions publiques, Paris : Karthala, Saint Louis : URED
Diallo, Ibrahima 2007 : Le droit des collectivités locales au Sénégal, Paris : L’Harmattan.
Faye, Jacques 2008 : Foncier et décentralisation : L’expérience du Sénégal, IIED, Dossier No. 149.
Lericollais, André 1999 : Paysans Sérère : Dynamiques agraires et mobilités au Sénégal, Paris : IRD.
Niang, Mamadou 1984 : Problèmes du Monde Rural en Afrique (préparation aux écoles de formations professionnelles et aux instituts de formation de développement rural), IFAN, janvier 1984.
Pélissier, Paul 1996 : Les paysans du Sénégal. Les civilisations agraires du Cayor à la Casamance, Editions Saint-Yrieix (Haute Vienne).
Sarr, Moussa 2008 : La gestion des terres dans la communauté rurale de FISSEL, Mémoire DEA, UFR SJP, UGB.
Senghor, Léopold Sédar 1961 : Nation et voie africaine du socialisme, Paris : Présence africaine.
Sow, Abdoul Aziz 2008 : Les ressources sociales dans la gestion des conflits fonciers : cas du conflit casamançais, in: Klute, Georg / Embaló, Birgit / Borszik, Anne-Kristin / Embaló, Idrissa (eds.): Local Experiences of Conflict Management – Experiencias Locais de Gestao de Conflitos, Soronda especial 2008, Bissau : INEP, pp. 273-286.
Traoré, Samba 1991 : Les systèmes fonciers dans la vallée du Sénégal. Exemple de la zone Soninké de Bakel : Canton du Goy-Gajaaga, Saint Louis : Thèse de l’Université Gaston Berger.
Traoré, Samba 1996 : « Quelle contribution de la décentralisation à la résolution des conflits liés à la gestion du pouvoir et des ressources naturelles ». Communication lors du séminaire sur la Régionalisation en 1996.
Traoré, Samba 2000 : « De la ‘divagation des champs’ : Difficultés d’application d’un principe coutumier de gestion partagée de l’espace pastoral au Ferlo (Sénégal) », in : Deville, P. Lavigne / Toulmin, Camilla / Traoré, Samba (éds.): Gérer le foncier en Afrique de l’Ouest. Dynamiques foncières et interventions publiques, Paris : Karthala, pp. 249-259.
Traoré, Samba 2006 : « La fille aînée du Sénégal cherche prétendant », in : Cahiers d’Anthropologie juridique, LAJP.
Si nous prenons le niveau de la communauté rurale, on pourrait analyser le phénomène des conflits fonciers sous différents angles liés aux enjeux et aux acteurs, pour aboutir au même résultat : la compétition sur les ressources et des situations conflictuelles permanentes. D’où toute l’importance d’un essai de typologie (A.) avant d’exposer les modes de règlement de ces conflits (B.).
A- Typologie des conflits fonciers
La survenance des conflits liés au foncier découle de l’enjeu que cette ressource suscite au niveau des populations particulièrement rurales. Le premier enjeu est celui lié au pouvoir local. En effet, il faut admettre aujourd’hui que le régime républicain a remis en cause le système de pouvoir local traditionnel. L’égalité devant la loi, l’égal accès aux fonctions et aux responsabilités reconnus par les textes fondamentaux vont entrainer un phénomène de contestation, même si l’on peut considérer qu’elle n’est pas toujours ouverte. Les anciens exclus du pouvoir traditionnel : anciens captifs, jeunes, femmes et même étrangers au terroir vont non seulement résister à la loi et aux sollicitations des autres acteurs, mais ils vont finir par adapter et domestiquer cette logique républicaine à leur profit : l’enjeu du pouvoir va se situer dans le contrôle des collectivités locales, par le biais d’un contrôle préalable des appareils des partis en compétition. Ainsi, les collectivités locales seront accaparées par des responsables politiques locaux qui se réclament des anciennes familles et catégories dirigeantes. Cet accaparement du pouvoir par des moyens légaux et démocratiques, par domestication de la loi, va constituer une cause de conflits parfois violents : il s’agit de scissions ou tentatives de scissions entre catégories sociales au sein des entités villageoises. Ces menaces vont ainsi devenir une arme et un moyen efficace et alternatif de gestion des conflits de ce type, parce que souvent par le dialogue des concessions peuvent être faites de part et d’autre.
L’autre enjeu est relatif au contrôle de la gestion des ressources naturelles. Il s’agit là de la manifestation la plus importante des conflits, parce que non seulement les droits peuvent être en cause, en plus ce sont les systèmes de production qui vont constituer le cœur de l’enjeu. L’enjeu politique du pouvoir local va trouver, au niveau des ressources naturelles, un terrain fertile à son développement et à celui des conflits. Parce que les acteurs à ces conflits peuvent être nombreux, divers, selon les ressources en cause. La violence des conflits dépend à la fois de l’importance de la ressource et du poids de l’acteur. Il y a aussi que les modes et instances de règlement de ces conflits nés de la compétition sur l’espace et les ressources de la collectivité locale dépendent de facteurs que ces collectivités ne maîtrisent pas toujours. Quant à la ressource foncière, elle est devenue, avec la loi 64-46 du 17 juin 1964, une ressource qui polarise toutes les convoitises, en éveillant l’instinct territorial des individus et du groupe. La terre est un bien appartenant à la Nation. Donc, égalité d’accès à la ressource et dans certaines conditions, égalité dans le pouvoir de contrôle. Mais ce pouvoir de contrôle et de gestion, s’il ne pose pas de problème dans sa logique et dans son articulation, est source de graves déséquilibres au niveau de son application par les collectivités locales, particulièrement les communautés rurales.
Les conditions d’affectation et de désaffectation, entre autre, de résidence et de mise en valeur participent de l’esprit d’égalité mais, sans définition, ni contenu précis donnés par les textes, les manipulations en deviennent aisées (Traoré 1996). De ce fait, chaque communauté rurale mettra en œuvre sa propre stratégie, qui parfois, est d’exclusion des autres acteurs. Les maitres fonciers traditionnels étant devenus les dirigeants des conseils ruraux, détiennent par ce biais tout le pouvoir foncier qui leur permet de combiner l’esprit de la loi et les mécanismes coutumiers de contrôle des terres. Les conséquences vont se manifester à différents niveaux, sources de conflits autour de cette ressource socle ; c’est que la pression sur la terre est telle que la compétition devient forte, voire plus violente, notamment quand des critères comme le statut de propriétaire foncier coutumier d’une terre est exigé des demandeurs d’affectation des terres du domaine national, dans certaines collectivités locales. Ce déséquilibre sociologique qui viole la loi, et qui a la bénédiction tacite des autorités de tutelle, au nom de la paix départementale, est source de conflits dont les conséquences sont parfois dramatiques. Mais les déviations de la logique foncière officielle se situent aussi à un niveau où la confrontation est la plus vive, où l’espace devient un enjeu de survie tant sur le plan des droits qu’à celui de la distribution de ces droits, c'est-à-dire l’utilisation des ressources.
C’est au niveau de la gestion de l’espace pastoral que cette confrontation est plus vive. Le fondement de ce biais se trouve dans l’absence de politique de mise en valeur pastorale, le refus de reconnaître, dans les politiques comme dans les pratiques, le pastoralisme comme forme de mise en valeur des terres du domaine national. L’affectation des terres du domaine national, dans la pratique des communautés rurales, ne se peut se concevoir que pour l’agriculture. L’élevage va ainsi devenir, en matière foncière et de gestion de l’espace et des ressources, une catégorie résiduelle. Même si théoriquement les terres du domaine national sont destinées à l’agriculture, l’élevage et l’habitat et que dès 1964, on a reconnu aux communautés rurales cette capacité d’affectation de l’espace en équilibre, dans la pratique, les conseils ruraux n’affectent des terres que pour l’agriculture. Et le texte qui est censé organiser l’élevage sur le domaine national lui-même, à savoir le décret 80-268 de mars 1980, a subi le même biais, parce que son objectif en réalité n’était pas de gérer cette activité, mais plutôt de sécuriser l’agriculteur en limitant dans un espace les parcours de bétail. Cet espace des parcours va servir à limiter les divagations dans les champs. Autrement dit, l’espace défini par ce décret était seulement celui de qui n’était pas utilisé pour l’agriculture. Le confinement de l’élevage dans cet espace réduit, l’avancée du front agricole favorisée par les politiques étatiques et communautaires constituent les sources des conflits les plus graves et les plus fréquents : conflits entre agriculteurs et éleveurs. Les exemples sur les enjeux et en même temps les causes des conflits peuvent être multipliés à l’infini car étant liés aux dysfonctionnements des structures décentralisées, mais aussi sur les textes relatifs au foncier, qui limitent les possibilités de mise en œuvre des mécanismes fiables de règlement des conflits.
Dans notre collectivité locale de recherche, nous avons noté qu’il existe d’une part des conflits au sein d’une même catégorie socioprofessionnelle et d’autre part des conflits opposant plusieurs catégories socioprofessionnelles. La prédominance des voies traditionnelles d’accès à la terre est souvent à l’origine des conflits fonciers. Ceux-ci peuvent être liés soit aux problèmes des conflits de droits coutumiers ou à la contestation des limites entre deux champs. Les sources susceptibles d’animer les conflits au sein des acteurs d’une même activité sont multiples. Il peut s’agir d’une revendication d’un droit à la terre par le maître de la terre au titulaire du droit de hache suite au non respect par ce dernier des obligations coutumières prenant la forme de redevances symboliques. Cette situation peut conduire à la remise en cause du droit de la hache qui est en principe un droit imprescriptible et héréditaire tant qu’il y avait respect par l’ancien borom ngadio ou son successeur de la hiérarchie, des liens de dépendance à l’égard du Lamane. C’est ainsi que le Conseil Rural a été saisi d’une affaire opposant un détenteur coutumier de droits fonciers à un usager légal. Le premier a invoqué le droit coutumier, la séniorité pour tenter de reprendre le champ, or l’usager a fait valoir la durée de son usager sur la parcelle. Le Conseil Rural a finalement donné le champ, objet du litige à l’usager parce que la loi ne reconnaît le droit de propriété mais le droit d’usage. Cependant, la majeure partie des conflits prend leur racine dans l’héritage de la terre communément appelé par la loi la problématique de la réaffectation des terres du défunt.
Par ailleurs, au niveau de cette localité, la délimitation des champs demeure encore une question brûlante et est à l’origine de multiples conflits. Les raisons de ce phénomène se justifient d’une part par la parcellisation excessive des lopins de terres et d’autre par une délimitation parfois superflue des champs. Néanmoins, il existe des pratiques locales de protection et de gestion des ressources naturelles. De telles pratiques s’inscrivent dans le souci de mieux conserver les sols et les ressources. Parmi celles-ci, on peut noter : la régénération naturelle assistée (le Salane), les clôtures (haies vives) etc. Toutefois, il faut préciser que de telles règles sont dépourvues d’une force juridique ; de ce fait, les plaignants ne peuvent en aucun cas s’en prévaloir devant l’autorité locale pour donner une suite favorable à leur demande. Mais, ces règles locales peuvent guider la décision du conseil rural en ce sens qu’elles lui permettent avec l’aide des témoins des parties au litige d’avoir une idée des limites des champs, objet du litige. A côté de ces catégories de conflits, on note que d’autres peuvent opposer des catégories socioprofessionnelles différentes.
Dans les zones de terroirs, on observe une compétition pour l’espace entre agriculteurs et éleveurs. Cette situation est souvent à l’origine des conflits entre les acteurs qui se livrent à ces activités. Ces conflits indirectement liés à une conquête foncière, peuvent émaner d’une part des situations où les champs sont détruits par les troupeaux ou des problèmes de parcours du bétail d’autre part.
B- Modes de règlements des conflits
Devant une situation conflictuelle découlant de la gestion du foncier dans le cadre du pluralisme juridique, des mécanismes de règlement sont activés afin d’apaiser la paix sociale. Il s’agit d’une part des modes traditionnels de résolution de ces litiges, qui sont les plus usités et des pratiques modernes de règlement de ces litiges d’autre part. L’accès à la terre a toujours donné lieu à des litiges dont la résolution fait appel à la mise en place d’un certain nombre de mécanismes. Ceux-ci peuvent revêtir la forme traditionnelle ou puiser leurs sources dans la religion. L’importance de la terre a suscité chez les sociétés traditionnelles la mise sur pied des méthodes visant à mettre fin aux conflits latents ou d’hostilités ouvertes. Ces méthodes consistent en une mise en place d’une commission des sages d’une part ou d’une institution comprenant les responsables locaux. Conformément aux normes coutumières en vigueur dans le monde rural, la gestion de la question foncière est confiée à des organes chargés de trouver une issue heureuse aux conflits fonciers. C’est la raison pour laquelle, « une commission des sages » (Deville / Toulmin / Traoré 1986 : 262) est instituée à chaque fois qu’un conflit éclate entre les catégories socioprofessionnelles. D’une nature ad hoc, elle est chargée de mettre fin aux conflits par voie de conciliation des parties ou de d’arbitrage. De ce fait, elle constitue la première instance de résolution des conflits de quelle que nature qu’elle soit.
L’efficacité de cette commission réside dans le fait que ses membres sont choisis par les parties en litige et ceux-ci ayant une maîtrise parfaite des règles de gestion de l’espace prennent généralement des décisions acceptées par les protagonistes. Généralement désignés parmi les chefs coutumiers, les membres de cette commission en tant qu’autorités morales, sont investis de pouvoirs de conciliation des parties en litige en ce qui concerne les problèmes de la terre. La fréquence et l’intérêt que revêt ce règlement traditionnel des litiges fonciers sont affirmés par le Professeur Samba Traoré en ces termes :
Les groupes de médiation foncière sont constitués par les acteurs traditionnels de la conciliation c'est-à-dire certaines catégories sociales tels que les anciens captifs […] et surtout les marabouts. Leur intervention met dés lors le conflit aux palabres avant qu’il n’arrive éventuellement à l’autorité administrative.
Les explications de l’intensité des modes d’usage de ces recours sont d’origines socioculturelles. En effet, dans cette localité, la solidarité est encore vivace car les habitants, en majorité Sérères, sont fortement unis par des liens de parenté qui marquent leur emprunte sur le fonctionnement de la collectivité.
Ainsi avec l’indépendance des chefs d’unité économique vis-à-vis du groupe pris comme collectivité, les conflits des chefs de carré ou des membres de carré différents ou non sont réglés par le groupe de trois ou les personnes dont la composition est fortement influencée par l’âge. Ce groupe comprend toujours des personnes connaissant l’histoire des différentes implantations familiales. Cette commission est constituée en cas de conflits opposant agriculteurs et éleveurs conformément à leur accord de deux médiateurs agriculteurs et de deux médiateurs éleveurs dont leur rôle consiste en l’estimation des dégâts sur la culture, afin de proposer une indemnisation que les parties, très souvent, acceptent. Plus connue sous le nom de « janbur » (Deville / Toulmin / Traoré 1986 : 263) dans la zone sylvo-pastorale, cette commission composée des chefs traditionnels en générale, est chargée d’estimer et de proposer une réparation pour les dégâts sur les cultures. Elle intervient aussi à la demande des parties dans les autres types de conflits relatifs à la gestion de l’espace. Ses décisions sont sécrètes, officieuses et orales. Cependant, elles sont susceptibles d’être attaquées devant le chef de village qui constitue l’arbitre suprême en matière de règlement par voie traditionnelle au niveau de l’espace villageois.
Ensuite, nous avons le chef de village. Le village africain est l’unité politico administrative où s’exercent les décisions du pouvoir central ; mais il est aussi un centre de distribution et de circulation des biens de la terre. Composé par un certain nombre de carrés, il est placé sous l’autorité d’un chef de village. Ce dernier est chargé d’apporter des solutions aux différentes questions y comprises les litiges dans le domaine de la terre. Son intervention se situe généralement après l’échec de la médiation de la commission des sages. Il peut être saisi par la partie contestataire de la décision de la commission des sages ou d’office par l’une des parties en conflit. Il choisit contrairement à la commission des sages, les personnes qu’il juge compétentes pour mettre un terme au cas d’espèce. A côté du chef de village, les organes religieux interviennent pour juguler certains conflits fonciers : il s’agit essentiellement de l’Imam ou des représentants des confréries religieuses.
A côté des voies classiques de résolution des conflits relatifs à la terre, d’autres instances de résolution des problèmes liés à la terre sont également mis en place par l’État. Il s’agit d’une part des organes locaux et d’autre part l’intervention de l’autorité administrative déconcentrée. La réglementation des problèmes de la terre fait intervenir après l’épuisement de la procédure de médiation et de conciliation les organes locaux qui sont officiellement investis de l’administration de la collectivité décentralisée. Cette intervention est d’abord du ressort du président du conseil rural et peut être aussi le fait de la commission domaniale. Organe collégial, le Conseil Rural représente les membres de la communauté rurale. Ces attributions foncières placent le Conseil Rural au cœur de la résolution des conflits qui découlent de la tenure des terres. L’examen des conflits recensés au niveau de la communauté rurale de Fissel permet de constater que les conflits se posent, pour l’essentiel, en termes de légitimation d’un droit. Il faut également préciser que, quelque soient les sources du conflit, la période de résolution est révélatrice. En effet, c’est généralement au moment de l’approche de l’hivernage que les litiges arrivent devant l’instance locale. Très souvent, à la lecture des arguments des parties, on apprend que les protagonistes ont préalablement recouru aux services d’une tierce personne avant la saisine du Conseil Rural par le biais de son président. Dans la tradition, la dénonciation d’un don de terre est une chose comprise et acceptée par tous. Il en est de même de la reprise d’un champ donné à gage qui peut survivre dès lors que la dette a été totalement honorée. Mais dans la loi gage et don sont inconnus et l’usage prime si l’on est en mesure de prouver sa qualité d’usage sur une longue durée. Dans les cas qui lui sont soumis, le conseil rural prend en général trois types de solution pour mettre définitivement un terme au conflit.
En outre, le Conseil Rural peut aussi déléguer cette tâche à la commission domaniale. Les enjeux de la terre dans les terroirs ont conduit à la mise en place des structures directement rattachées au Conseil Rural qui sont chargés d’aider celui-ci dans les tâches relatives à la gestion des questions foncières. Cette commission domaniale exerce ces compétences pour le compte du Président Conseil Rural. En effet, celui-ci est la première instance responsable de la gestion des terres du Domaine National. Il en est ainsi dans la mesure où aux termes des dispositions de l’article 209 de la loi 96-06 du 22 mars 1996 du CCL, le Président du Conseil Rural est l’organe exécutif de la Communauté Rurale. Toutefois, l’article 299 de cette même loi autorise le Conseil Rural à former des commissions pour l’étude des questions entrant dans ses attributions et le Président du Conseil Rural, dans ses fonctions exécutives, délègue en général en permanence ce pouvoir de règlement des litiges à la commission domaniale qui constitue l’organe le plus important du Conseil, parce que elle instruit tous les dossiers fonciers de la demande d’affectation et au suivi de la mise en valeur. Considérée comme une sorte d’observatoire, cette commission connaît toutes les questions qui peuvent se poser en matière domaniale. De ce fait, elle instruit les demandes et plaintes et donne la solution. Concernant certains litiges liés à la terre, la commission se rend souvent sur les lieux pour entendre les parties et les témoins. Après cette phase, un consensus est généralement trouvé avec les parties sous réserve d’une délibération du Conseil Rural à cet effet. Mais en pratique, à part les litiges entre héritiers d’un affectataire, les contestations mineures pour double affectation, ou les litiges concernant les délimitations, les confits fonciers les plus importants ne sont traités par le Conseil, parce qu’elle ne dispose pas d’un pouvoir de coercition.
Cependant, quels que soient l’efficacité de ces organes locaux dans la résolution des problèmes relatifs à l’usage de la terre, il est aussi évident que les autorités déconcentrées sont sollicitées de plus en plus par les populations pour trouver une solution à leur litige. Le Représentant de l’État par ses attributions, intervient dans tous les domaines où la collectivité locale a reçu compétence conformément à la loi. Ainsi, en matière foncière par le biais de son pouvoir d’approbation, il règle en amont les problèmes liés à la terre ; de même, il peut être saisi en tant qu’autorité pour mettre fin à un litige foncier. Le contrôle de légalité est un moyen de prévention des problèmes fonciers. La gestion foncière locale est le fait de deux principaux intervenants : le Conseil Rural et l’administration. Cette dernière est représentée par le sous-préfet et les agents de services administratifs chargés de mener la politique de développement retenue par les pouvoirs publics. L’importance de l’autorité déconcentrée réside dans le fait qu’elle est dotée de pouvoirs lui permettant de contrôler les actes pris par les organes locaux conformément aux règlements en vigueur.
A côté du conseil rural, l’administration territoriale locale (préfet et sous-préfet) a acquis depuis longtemps une importance de premier plan. Bien que juridiquement, à part les recours administratifs, ces instances ne soient pas habilitées à gérer les conflits fonciers, les plaintes les plus nombreuses et les plus fréquentes sont acheminées vers ces autorités. Et parfois au mépris des règles et principes qui les régissent, elles se substituent à l’instance régulière pour régler des cas, par contournement des textes et des procédures. Cependant, ces « instances ne doivent en aucune façon s’immiscer dans la gestion foncière » . Cependant, la tutelle administrative autorise ces organes à prendre des décisions parfois en marge de la réglementation en vigueur. Il en est ainsi dans la mesure où la peur du « commandant » est telle, depuis la période coloniale, qu’on hésite à l’attaquer en justice. C’est pourquoi, les parties en cause contestent la décision arrêtée par le conseil rural lors du règlement d’un litige, elles ont la possibilité de recourir pour arbitrage au sous-préfet dans le mois qui suit la notification. A cet effet, l’article 19 du décret 72-1128 : « toute personne qui se prétend lésée par une affectation ou une désaffectation peut recourir au sous-préfet, dans le mois qui suit la notification ». En outre, ce même article dans al 2 dispose que :
Le sous-préfet peut décider d’annuler la décision ou d’en suspendre l’exécution, soit sur la réclamation de la partie intéressé, soit d’office par inopportunité, mauvaise appréciation des circonstances ou violations des lois règlements en vigueur.
Le recours à la justice (tribunaux) est rarement une solution dans la mesure où, très souvent, ces mécanismes locaux et traditionnels de gestion des conflits arrivent à régler les différends, faisant ainsi du recours juridictionnels une exception.
Conclusion
La loi sur le domaine national et le code des collectivités locales ont donné des compétences de gestion des terres aux communautés de base. Cependant, au regard de la forte prégnance du droit coutumier, cette application des deux textes juridiques est fortement limitée, rendant impossible toute tentative de ‘domestication’ du rural. Si le droit positif contenu dans ces textes juridiques a été considéré comme des innovations dans la perspective de moderniser le monde rural, il faut avouer que ces derniers ont échoué. D’ailleurs, des réformes du droit de la décentralisation et du droit de la terre sont en cours. Mais, il faut avouer que toute initiative tendant à contourner les logiques et pratiques foncières locales serait inopérante ; à la limite, ces textes juridiques resteront ineffectifs, et seront à la limite des sources de conflits. D’où l’impératif de prendre en compte dans la perspective de toute réforme les aspects pertinents du droit coutumier.
Bibliographie
Chabbas, Jean 1965 : « Le domaine national du Sénégal : réformes foncière et agraire », in : Annales Africaines, pp. 37-70.
Crousse, Bernard / Le Bris, Émile / Le Roy, Étienne (éds.) 1986 : Espaces disputés en Afrique Noire : Pratiques foncières locales, Paris : Karthala.
Deville, Philippe Lavigne / Toulmin, Camilla / Traoré, Samba (éds.) 2000 : Gérer le foncier en Afrique de l’Ouest. Dynamiques foncières et interventions publiques, Paris : Karthala, Saint Louis : URED
Diallo, Ibrahima 2007 : Le droit des collectivités locales au Sénégal, Paris : L’Harmattan.
Faye, Jacques 2008 : Foncier et décentralisation : L’expérience du Sénégal, IIED, Dossier No. 149.
Lericollais, André 1999 : Paysans Sérère : Dynamiques agraires et mobilités au Sénégal, Paris : IRD.
Niang, Mamadou 1984 : Problèmes du Monde Rural en Afrique (préparation aux écoles de formations professionnelles et aux instituts de formation de développement rural), IFAN, janvier 1984.
Pélissier, Paul 1996 : Les paysans du Sénégal. Les civilisations agraires du Cayor à la Casamance, Editions Saint-Yrieix (Haute Vienne).
Sarr, Moussa 2008 : La gestion des terres dans la communauté rurale de FISSEL, Mémoire DEA, UFR SJP, UGB.
Senghor, Léopold Sédar 1961 : Nation et voie africaine du socialisme, Paris : Présence africaine.
Sow, Abdoul Aziz 2008 : Les ressources sociales dans la gestion des conflits fonciers : cas du conflit casamançais, in: Klute, Georg / Embaló, Birgit / Borszik, Anne-Kristin / Embaló, Idrissa (eds.): Local Experiences of Conflict Management – Experiencias Locais de Gestao de Conflitos, Soronda especial 2008, Bissau : INEP, pp. 273-286.
Traoré, Samba 1991 : Les systèmes fonciers dans la vallée du Sénégal. Exemple de la zone Soninké de Bakel : Canton du Goy-Gajaaga, Saint Louis : Thèse de l’Université Gaston Berger.
Traoré, Samba 1996 : « Quelle contribution de la décentralisation à la résolution des conflits liés à la gestion du pouvoir et des ressources naturelles ». Communication lors du séminaire sur la Régionalisation en 1996.
Traoré, Samba 2000 : « De la ‘divagation des champs’ : Difficultés d’application d’un principe coutumier de gestion partagée de l’espace pastoral au Ferlo (Sénégal) », in : Deville, P. Lavigne / Toulmin, Camilla / Traoré, Samba (éds.): Gérer le foncier en Afrique de l’Ouest. Dynamiques foncières et interventions publiques, Paris : Karthala, pp. 249-259.
Traoré, Samba 2006 : « La fille aînée du Sénégal cherche prétendant », in : Cahiers d’Anthropologie juridique, LAJP.


 Décentralisation, domanialité nationale et gestion des conflits fonciers à l’aune du pluralisme juridique au Sénégal
Décentralisation, domanialité nationale et gestion des conflits fonciers à l’aune du pluralisme juridique au Sénégal