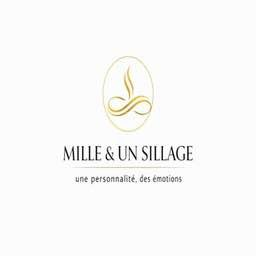En visite de travail à Dakar, le ministre français délégué auprès du ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt, chargé de l’Agroalimentaire, Guillaume Garot, a évoqué avec Le Soleil les nouveaux rapports de partenariat que la France compte développer avec l’Afrique. Ce pays va accompagner le développement des entreprises agroalimentaires du Sénégal.
Pourquoi avez-vous choisi le Sénégal pour votre première visite en Afrique après votre nomination ?
«C’est normal que ma première visite en Afrique comme ministre de l’Agroalimentaire soit consacrée au Sénégal. Parce que c’est une histoire commune très forte et le Sénégal est aussi un pays d’une maturité exemplaire, notamment sur le plan politique. Mais, au-delà, nous avons beaucoup à faire ensemble ; nous avons un avenir commun tout aussi riche. Cependant, cela doit se faire sur la base de relations claires, franches, fondées sur un partenariat, un rapport d’égalité, juste et simple».
Pourquoi avez-vous choisi le Sénégal pour votre première visite en Afrique après votre nomination ?
«C’est normal que ma première visite en Afrique comme ministre de l’Agroalimentaire soit consacrée au Sénégal. Parce que c’est une histoire commune très forte et le Sénégal est aussi un pays d’une maturité exemplaire, notamment sur le plan politique. Mais, au-delà, nous avons beaucoup à faire ensemble ; nous avons un avenir commun tout aussi riche. Cependant, cela doit se faire sur la base de relations claires, franches, fondées sur un partenariat, un rapport d’égalité, juste et simple».
Est-ce qu’on peut avoir un partenariat équilibré, un rapport d’égalité, comme vous le dites, entre des pays dont les niveaux de développement sont très différents ?
«Je crois qu’il y a une volonté partagée d’avancer et de s’épauler. Je ne suis pas là pour dire nous savons tout et nous allons tout vous apprendre. Nous avons beaucoup à apprendre de l’Afrique. Je sais que nous devons être dans un véritable échange. Je sais que les niveaux de développement ne sont pas les mêmes, certes, mais depuis mon arrivée, j’ai rencontré des chefs d’entreprise et les questions qu’ils se posent sont à peu près les mêmes que me posent les chefs d’entreprises français.
C’est là que les échanges sont intéressants. C’est-à-dire que nous pouvons bénéficier des bonnes pratiques des uns et des autres. Il y a un potentiel magnifique au Sénégal et nous pouvons être utiles pour aider les entreprises sénégalaises sur des questions de formation, d’ingénierie de projet, de labels. Et inversement, je suis convaincu que la jeunesse française à beaucoup à apprendre de la jeunesse sénégalaise».
Vous avez soutenu, lors de votre conférence à l’Ucad, que l’agroalimentaire est l’un des défis majeurs du 21ème siècle. Pourquoi, selon vous ?
«En 2050, nous aurons une population mondiale de 9 milliards de personnes. Selon la Fao, il faut que la production agricole mondiale soit augmentée de près 60 % pour que chaque être humain ait accès à une nourriture suffisante et de qualité. Donc, il va de soi que nous devons accompagner cette évolution démographique sur la production, mais aussi sur la transformation, parce que c’est là que nous allons créer des richesses, c’est là que nous allons créer de l’emploi. Donc, le défi alimentaire, c’est bien celui là. C’est aussi important que l’air que nous respirons, l’eau que nous buvons, l’énergie que nous utilisons. C’est pourquoi il faut investir massivement dans les industries de l’alimentation, partout, en France comme au Sénégal».
Vous avez également parlé de justice alimentaire. Est-ce qu’on peut avoir une idée de ce que renferme ce concept ?
«A travers ce concept, il s’agit d’augmenter la production, d’accompagner la production par la transformation. Ensuite, il faut qu’il y ait une juste répartition des activités et de la consommation. Il faut que chacun puisse avoir accès à une alimentation de qualité et suffisante.»
Concrètement, qu’est-ce que la France compte faire pour appuyer le Sénégal dans le secteur de l’agroalimentaire ?
«Dès demain (aujourd’hui, Ndlr), je signerai, avec mon homologue du Commerce, de l’Industrie et du Secteur informel, un partenariat pour simplifier et améliorer les échanges entre la France et le Sénégal autour des industries agroalimentaires. Cela veut dire davantage de formation, d’accompagnement des entreprises, un accès plus simple des marchés des uns et des autres. C’est important si nous voulons fluidifier les échanges, mais dans le respect des normes des organisations régionales. Toutefois, cette convention que nous signons est une nouvelle étape pour aller plus loin ensuite. Nous avons sur les deux rives de la méditerranée des problèmes qui sont finalement les mêmes, des difficultés que nous devons, chacun, surmonter dans nos pays. Et pour mieux les surmonter pourquoi ne pas travailler ensemble ?»
Propos recueillis par Elhadji Ibrahima THIAM
Le Soleil
«Je crois qu’il y a une volonté partagée d’avancer et de s’épauler. Je ne suis pas là pour dire nous savons tout et nous allons tout vous apprendre. Nous avons beaucoup à apprendre de l’Afrique. Je sais que nous devons être dans un véritable échange. Je sais que les niveaux de développement ne sont pas les mêmes, certes, mais depuis mon arrivée, j’ai rencontré des chefs d’entreprise et les questions qu’ils se posent sont à peu près les mêmes que me posent les chefs d’entreprises français.
C’est là que les échanges sont intéressants. C’est-à-dire que nous pouvons bénéficier des bonnes pratiques des uns et des autres. Il y a un potentiel magnifique au Sénégal et nous pouvons être utiles pour aider les entreprises sénégalaises sur des questions de formation, d’ingénierie de projet, de labels. Et inversement, je suis convaincu que la jeunesse française à beaucoup à apprendre de la jeunesse sénégalaise».
Vous avez soutenu, lors de votre conférence à l’Ucad, que l’agroalimentaire est l’un des défis majeurs du 21ème siècle. Pourquoi, selon vous ?
«En 2050, nous aurons une population mondiale de 9 milliards de personnes. Selon la Fao, il faut que la production agricole mondiale soit augmentée de près 60 % pour que chaque être humain ait accès à une nourriture suffisante et de qualité. Donc, il va de soi que nous devons accompagner cette évolution démographique sur la production, mais aussi sur la transformation, parce que c’est là que nous allons créer des richesses, c’est là que nous allons créer de l’emploi. Donc, le défi alimentaire, c’est bien celui là. C’est aussi important que l’air que nous respirons, l’eau que nous buvons, l’énergie que nous utilisons. C’est pourquoi il faut investir massivement dans les industries de l’alimentation, partout, en France comme au Sénégal».
Vous avez également parlé de justice alimentaire. Est-ce qu’on peut avoir une idée de ce que renferme ce concept ?
«A travers ce concept, il s’agit d’augmenter la production, d’accompagner la production par la transformation. Ensuite, il faut qu’il y ait une juste répartition des activités et de la consommation. Il faut que chacun puisse avoir accès à une alimentation de qualité et suffisante.»
Concrètement, qu’est-ce que la France compte faire pour appuyer le Sénégal dans le secteur de l’agroalimentaire ?
«Dès demain (aujourd’hui, Ndlr), je signerai, avec mon homologue du Commerce, de l’Industrie et du Secteur informel, un partenariat pour simplifier et améliorer les échanges entre la France et le Sénégal autour des industries agroalimentaires. Cela veut dire davantage de formation, d’accompagnement des entreprises, un accès plus simple des marchés des uns et des autres. C’est important si nous voulons fluidifier les échanges, mais dans le respect des normes des organisations régionales. Toutefois, cette convention que nous signons est une nouvelle étape pour aller plus loin ensuite. Nous avons sur les deux rives de la méditerranée des problèmes qui sont finalement les mêmes, des difficultés que nous devons, chacun, surmonter dans nos pays. Et pour mieux les surmonter pourquoi ne pas travailler ensemble ?»
Propos recueillis par Elhadji Ibrahima THIAM
Le Soleil


 Guillaume Garot, ministre français délégué en charge de l’Agroalimentaire : « La France va accompagner les entreprises agroalimentaires du Sénégal »
Guillaume Garot, ministre français délégué en charge de l’Agroalimentaire : « La France va accompagner les entreprises agroalimentaires du Sénégal »